Moscou et les révolutions de couleur : une guerre des modèles politiques?
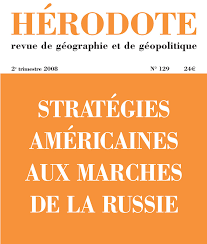
« Les pierres et les parpaings du mur de Berlin ne sont plus que des souvenirs. Mais il ne faut pas oublier que sa chute a été rendue possible par un choix historique, et en particulier un choix historique effectué par notre peuple, le peuple de Russie, un choix en faveur de la démocratie et de la liberté, de l’ouverture et d’un partenariat authentique avec tous les membres de la grande famille européenne. Maintenant, on essaie de tracer de nouvelles lignes de partage, de construire de nouveaux murs, certes virtuels, mais qui n’en divisent pas moins notre continent ! Faudra-t-il de nouveau des décennies, l’alternance de plusieurs générations de dirigeants pour faire tomber ces nouveaux murs ? »[1]. Vladimir Poutine, discours prononcé à Munich, 10 février 2007.
Dans les années 1990, sous l’effet de l’onde de choc de la chute de l’URSS et du bouleversement subséquent de l’ordre bipolaire du monde, la Russie et la quasi-totalité des anciennes républiques soviétiques devenues indépendantes se contentaient de signaler qu’elles étaient « en transition vers la démocratie », ce qui sous-entendait, du moins en apparence, leur ralliement à un modèle politique occidental qui paraissait triompher de l’Histoire (Fukuyama, 1992). En 2008, la grande secousse de la fin du communisme paraît dissipée, aussi bien que les illusions qu’elle charriait, et l’on constate que la question démocratique est diversement résolue dans l’espace post-soviétique. Certains pays se sont engagés dans une voie résolument autoritaire (Ouzbékistan, Biélorussie), voire totalitaire (Turkménistan), sans que cela ait nécessairement pour conséquence (Biélorussie exceptée) l’adoption de leur part d’une politique étrangère hostile à l’axe euro-atlantique (Laruelle et Peyrouse, 2005; Goujon, 2002). En 2004, les trois Etats baltes, désormais accordés au diapason de la démocratie occidentale, ont rejoint l’OTAN et l’Union européenne. Pour tous les autres pays, l’apposition à leur sujet du qualificatif de démocratie continue de faire débat, tandis que s’installent de nouveaux régimes et que s’épuise l’argumentation jusqu’ici dominante fondée sur les difficultés de la « transition ».
La question démocratique est un enjeu majeur des « guerres de l’information », champ polémologique crucial des relations internationales de l’après-guerre froide (Huyghe, 2004). Parmi les Etats post-soviétiques membres de la CEI, si l’on excepte ceux qui ont opté pour le maintien d’un certain silence officiel sur la question (Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Kirghizie), deux stratégies bien distinctes ont été engagées. Après la « révolution des roses » et la « révolution orange », intervenues respectivement en Géorgie (2003) et en Ukraine (2004), les nouveaux dirigeants de ces deux Etats ont clairement indiqué qu’ils entendaient suivre la voie tracée par les Etats baltes. En revanche, au Kazakhstan, l’on a assisté au développement d’une rhétorique officielle, reprise au plus haut niveau de l’Etat, justifiant par sa spécificité « eurasiatique » le régime semi-autoritaire mis en œuvre par le Président Nazarbaïev. En Russie, un discours spécifiste s’est lui aussi constitué dans l’entourage du Président Poutine et dans le sillage du parti qui le soutient, Russie Unie, qui dispose d’une majorité écrasante à la Douma et dans les assemblées régionales. Son principal promoteur, Vladislav Sourkov, chef-adjoint de l’administration présidentielle, a développé l’idée que la Russie des années 2000 poursuivait la construction de son propre modèle démocratique, la « démocratie souveraine », un système politique « qui met la démocratie au service de la reconstruction de l’Etat et de la souveraineté nationale »[2]. L’idéologue de Russie Unie sous-entend que l’adhésion au modèle occidental implique qu’un Etat doive se départir de tout ou partie de sa souveraineté pour pouvoir être admis au « club des démocraties »…
Si la « démocratie souveraine » n’a jamais été reprise par le Président Poutine et qu’elle a même été rejetée comme proprement tautologique par le futur Président Medvedev, la rhétorique « souverainiste » forme le nouvel axe du discours officiel, qui s’articule autour de la reconstruction de la puissance russe, un objectif décrit comme inéluctable. Le « discours de Munich » de Vladimir Poutine indique que la Russie est un pays condamné par sa géographie et son histoire à devenir l’un des pôles du monde multipolaire en devenir, la Russie n’ayant pas vocation à s’aligner sur un axe, quel qu’il soit. Généralement mal perçue – et tout d’abord mal comprise – cette inflexion du discours est souvent présentée, dans les médias occidentaux, comme un indice récurrent parmi d’autres d’une dérive autoritaire du système politique russe que certains commentateurs montrent régulièrement du doigt depuis l’avènement de Vladimir Poutine au pouvoir (2000) et, d’une manière plus générale, après l’affaire Khodorkovski et les « révolutions de couleur ». Observons que ce discours, dont les premiers destinataires furent les cadres de Russie Unie, légitime d’abord un état de fait, celui d’une démocratie russe illibérale, non-compétitive et d’essence plébiscitaire (Raviot, 2008). Cette entreprise de banalisation du système politique russe – « une démocratie inachevée, mais une démocratie quand même »[3] – intervient à l’heure où, en Occident, l’unanimité commence à s’opérer, sur les champs de bataille de la « guerre de l’information », autour de l’idée que la Russie « s’est perdue dans la transition » et a basculé dans le camp des régimes autoritaires (Shevtsova, 2007). Dans ce contexte, la « démocratie souveraine » n’est-elle qu’une idéologie de circonstance à usage interne, née dans les coulisses du pouvoir et destinée à s’y enliser à plus ou moins brève échéance, ou bien l’un des éléments d’une nouvelle stratégie d’influence à l’échelle régionale, voire européenne, à l’heure de la controverse sur l’opportunité de l’accession du Kosovo à l’indépendance? Après les « révolutions de couleur », assiste-t-on à l’émergence d’un soft power russe destiné à contrer un « impérialisme démocratique américain » qui ne poursuivrait d’autre objectif que de multiplier les « manœuvres de déstabilisation de la Russie » (Tinguy, 2008, pp. 70-71) ?
La question démocratique au cœur de la polémologie contemporaine
Si les institutions de la Fédération de Russie et les principes qui les fondent satisfont formellement aux critères de la « bonne gouvernance » édictée par les organisations internationales, les pratiques du système politique russe et les mentalités de ses acteurs ne semblent guère conformes aux normes universelles de la démocratie tels qu’elles sont édictées par les cercles dirigeants des Etats de l’axe euro-atlantique. Observons que le contenu de cet universel démocratique est d’un tel niveau de généralité (par exemple, les « élections libres et équitables » de l’OSCE…) que son application dépend forcément d’une grille d’interprétation résultant d’un consensus le plus souvent implicite dont les conditions d’élaboration révèlent le caractère éminemment contingent des normes en question. Ainsi, l’universel démocratique de notre temps, perméable à l’air du temps et intimement lié aux rapports de force internationaux du moment, s’appuie sur une conception idéologique de la démocratie, au sens polémiste que Jean Baechler donne à cet adjectif (Baechler, 2002). Rappelons qu’il existe un hiatus entre la démocratie comme idéal politique et la démocratie comme régime politique. Peu avant la première guerre mondiale, à l’heure où les élites européennes saluaient presque unanimement la généralisation de la démocratie parlementaire sur le continent comme un élément insécable de la modernité triomphante, Robert Michels jouait les trouble-fête en faisant valoir que la domination d’une minorité sur la majorité était une donnée intrinsèque à la nature sociale et que la démocratie au sens littéral du terme ne pouvait être qu’une illusion… Au début du XXIème siècle, la loi d’airain de l’oligarchie mise en évidence par Michels (Michels, 1914) relève presque de la tautologie, tant les grandes démocraties sont dirigées par des élites du pouvoir marquées par un degré assez élevé de cohésion et d’intégration. Toutes les démocraties sont en réalité des « démocraties à guichet fermé », caractérisées par une étroite connivence des élites politiques, économiques, intellectuelles et médiatiques et où le jeu politique, plus ou moins ouvert selon les pays à des formations tribunitiennes qui, le cas échéant, disposent d’une grande audience et des électorats importants, est verrouillé par les grands partis politiques (ou les grandes coalitions) qui contrôlent l’accès au pouvoir de décision. Ainsi, le hiatus entre la « démocratie idéale » et la « démocratie réelle » alimente une question démocratique, par définition inépuisable, dont l’instrumentalisation à des fins politiques est devenue un des terrains symboliques privilégiés du déploiement des rapports de force internationaux de l’après-guerre froide. L’appartenance au « club des démocraties » ou, à défaut, l’engagement pris par leurs dirigeants d’y entrer à plus ou moins brève échéance conditionne le rang des Etats du monde au sein de la « communauté internationale » et surtout, dans de nombreux cas, l’octroi de certains avantages économiques. Dans ces conditions, tous les Etats du globe revendiquent la précieuse qualité de démocratie, en justifiant si nécessaire certaines dérogations en invoquant des spécificités d’ordre culturel ou religieux. C’est ainsi qu’un nombre croissant de régimes politiques qui se définissent comme démocratiques ne ressemblent plus guère à la matrice occidentale dont ils prétendent s’inspirer. Plus elle se décline à l’universel, plus la question démocratique est en quelque sorte résolue en ayant recours à une gamme de plus en plus variée de solutions politiques et institutionnelles. Fareed Zakaria a bien décrit ces « démocraties illibérales » qui se sont multipliées au cours de ces trente dernières années (Zakaria, 2003). Dès lors, plus la « démocratie réelle » devient difficile à définir, plus la teneur idéologique et polémique (au sens propre du terme) des réponses apportées à la question démocratique dans les divers pays du globe est forte. La qualité de « démocratie » ne se gagne plus seulement dans le monde réel, mais aussi, et peut-être surtout, dans un espace polémique virtuel, sur les nouveaux champs de bataille de la « guerre du sens », les « champs psychologiques » de la guerre de l’information (Francart, 2000).
La Democracy Promotion : de la guerre froide à la « guerre du sens »
Les outrances de l’instrumentalisation polémique de la question démocratique passent d’autant plus inaperçues qu’elles sont en quelque sorte « noyées » dans un flot d’information continue dont la surabondance n’a d’égal que l’absence de toute hiérarchisation préétablie. Dans ces conditions, tous les moyens sont bons, y compris les amalgames et les raccourcis, pour orienter le curseur qui oriente favorablement ou défavorablement la « cote » démocratique de tel ou tel pays sur le marché global de l’information. Ainsi, le rapport annuel de Human Rights Watch pour 2006 décrit la Fédération de Russie comme un « pays fermé et autoritaire » où « de nombreux droits fondamentaux sont ouvertement bafoués » et la démocratie « entravée par la forte censure étatique sur les médias »[4]. Faisant état d’une conception pour le moins restrictive de la démocratie – ses auteurs ne mentionnant pas même les élections comme critère d’évaluation – l’ « échelle des libertés » établie chaque année par Freedom House classe la Russie parmi les pays « non-libres », dans la même catégorie que la Corée du Nord, Cuba, la Chine ou l’Arabie Saoudite, des pays qui ont banni tout pluralisme idéologique et électoral[5]… Ces deux ONG, qui ont toutes deux leur siège aux Etats-Unis et déploient leur activité à l’échelle de la planète, font partie d’une kyrielle d’organisations du même type que leurs détracteurs présentent volontiers comme des officines de la CIA, ou du moins comme des structures permettant de déployer ou de recruter localement des agents de renseignement ou d’influence sous couverture. Les « révolutions de couleur » des années 2000 ont donné lieu à une série d’analyses en ce sens. Rappelons que si certaines de ces fondations, ONG ou think tanks ont vu le jour dans l’entre-deux-guerres, ces organisations ont pour la plupart été créées pour fournir l’arsenal de la politique étrangère américaine pendant la guerre froide. La politique américaine de promotion de la démocratie a connu un essor décisif sous l’administration Reagan (1980-1988). La référence à la démocratie en tant qu’ « ensemble de valeurs universelles et intangibles » devient une « arme dans la guerre idéologique entre le camp soviétique et le “monde libre“ » (Cox et alii, 2000, p. 17) et, dans cet objectif, une fondation publique, National Endowment for Democracy, est instituée en 1983 pour appuyer les entreprises de démocratisation ou, plus directement, les oppositions aux régimes communistes et autres Etats ennemis des Etats-Unis. La promotion de la démocratie consiste à propager les idées libérales et, ce faisant, à susciter et à soutenir les forces politiques, économiques et sociales favorables aux Etats-Unis et aux « valeurs occidentales » (Carrothers, 1991). William Robinson a mis en lumière la grande cohérence idéologique de la Democracy Promotion, qui s’articule autour de l’idée de la «promotion de la polyarchie», dont le principal objectif est la «promotion des factions pro-américaines des élites des divers pays du monde» (Robinson, 1996, p. 18). La notion de polyarchie renvoie à un débat qui a agité la science politique américaine tout au long des années 1960 et dont l’enjeu était ni plus ni moins que la reconnaissance du caractère réellement démocratique du système politique américain. Contre les tenants de la thèse néo-élitiste, inspirée notamment par la relecture des travaux précités de Robert Michels, Robert Dahl a cherché à montrer que c’est l’existence d’une véritable polyarchie – une élite dirigeante scindée en groupes d’intérêts et partis en concurrence permanente pour le pouvoir – qui constitue l’essence des démocraties liberals (Dahl, 1989). Bien au-delà de ses enjeux théoriques ou académiques, ce débat avait une forte connotation politique. En bonne logique, la thèse de Dahl fut bien reçue «à droite», car elle permettait d’opposer des arguments réalistes, relevant presque du bon sens, à une critique «de gauche» des dérives «anti-démocratiques» du système politique américain très en vogue à l’heure du Vietnam et du flower power… William Robinson observe que cette redéfinition a minima de la démocratie aboutit à considérer comme démocratique des systèmes politiques qui ne représentent que les cercles dirigeants et ne s’appuient pas sur de fortes majorités électorales. Dans une autre critique magistrale des entreprises américaines d’exportation de la démocratie, Amy Chua dénonce un « cynisme démocratique » qui consiste à appuyer des régimes formellement démocratiques mais profondément impopulaires, voire illégitimes, car dominés par une minorité (ou une coalition de minorités) sociale ou ethnique pro-occidentale (Chua, 2007).
N’est-il pas dommageable de promouvoir le respect des procédures démocratiques et le pluralisme partisan lorsque ceux-ci attisent les conflits sociaux et les rivalités interconfessionnelles ou interethniques, affaiblissant encore davantage des Etats faibles ? Cette argumentation est celle de la « démocratie souveraine » développée depuis 2005 par certains conseillers politiques du Kremlin, qui se présente comme une réplique à l’impératif polyarchique inscrit au frontispice de l’édifice de la « démocratie comme idéologie » promue par l’axe euro-atlantique. En dépit de son indéniable pertinence, cette critique est-elle en mesure de contrebalancer l’attrait puissant que la « promotion de la polyarchie » est susceptible d’exercer dans des espaces politiques non-compétitifs ? Dans les anciennes périphériques de l’URSS, l’efficacité de cette « arme idéologique fournie par le camp occidental pour affaiblir les Etats », pour citer un éditorialiste russe très critique à son égard (Prokhanov, 2007), ne peut guère être discutée. Comme l’ont bien montré les « révolutions de couleur », aussi simpliste qu’elle fût – « pas de démocratie sans alternance » – la force de son evidence est sans égal pour rassembler les ressources, hétérogènes et disparates, d’une mobilisation politique qui vise à faire sauter le verrou qu’un parti du pouvoir devenu impopulaire a instauré sur le jeu politique. L’ultima ratio du « démocratisme de couleur » n’est autre que la reformulation de l’essence du libéralisme, si bien résumée par Karl Popper par la formule « la démocratie, ça sert d’abord à permettre aux gouvernés de se débarrasser de mauvais gouvernants » (Popper, 1992, p. 106). Bien avant la publication du manuel de Gene Sharp – souvent présenté comme le « petit livre rouge » des « révolutions de couleur » – ce raisonnement simple et presque performatif avait pénétré les consciences, notamment par le biais des manuels de science politique édités dans l’espace post-soviétique par la Fondation Soros dont le président, le financier George Soros, se présente comme un épigone de la pensée politique du philosophe viennois (Soros, 2004). Si l’action des organisations américaines sur le terrain post-soviétique marque un trait d’union entre l’ « ancienne » guerre froide et la « nouvelle guerre froide », cette continuité en rencontre, par symétrie, une autre. Les « révolutions de couleur » doivent être analysées dans la lignée des mobilisations nationales qui ont marqué, en Ukraine et en Géorgie notamment, la sortie de l’Empire soviétique et l’accession à l’indépendance (Goujon, 2005; Avioutskiï, 2006), de sorte que le nouveau paysage polémique reproduit peu ou prou celui qui existait déjà quinze ans plus tôt : une nouvelle nomenklatura a succédé à l’ancienne, toujours liée à Moscou, toujours avide de monopoliser le pouvoir et les richesses… Aucun « modèle russe » alternatif ne pourra jamais, dans un tel contexte historique et politique, rivaliser avec la politique américaine de « promotion de la démocratie ».
Après les « révolutions de couleur » : de la riposte à la retraite
Pour Vladimir Poutine et les dirigeants russes en général, la victoire de Viktor Iouchtchenko à la présidentielle ukrainienne de 2004 a constitué une veritable humiliation. Le soutien sans faille apporté par le Kremlin à la candidature du perdant, Viktor Ianoukovitch – héritier du très impopulaire Président sortant, Leonid Koutchma – a mis en pleine lumière la profonde méconnaissance qu’avaient alors les cercles dirigeants de Moscou des réalités politiques internes les plus élémentaires d’un pays qui est non seulement le plus important de tous ceux de l’ « étranger proche », mais encore l’un de tout premiers partenaires économiques et commerciaux et, enfin, le verrou de la politique européenne de la Russie. Au-delà de cet épisode décisif, les « révolutions de couleur » ont montré que la politique russe à l’égard des pays de l’ « étranger proche » – même les plus importants – se résumait à un discours obligé sur la coopération, souvent récité sans enthousiasme, quelques réseaux d’influence militaire, sécuritaire et industrielle dont les origines remontent au début des années 1990, et beaucoup de préjugés tenaces fondés sur la conviction, très répandue et trompeuse, que dans les pays de l’espace post-soviétique, tout ressemble plus ou moins à la Russie. Pénétrés de la réalité de l’existence d’une telle symétrie, les dirigeants moscovites ont dépêché à Kiev, pour garantir l’élection de Viktor Ianoukovitch, les meilleurs politologues russes reconvertis en conseillers du Prince – les polittekhnologui) – quelque peu sous-employés en Russie après la réélection triomphale (et sans campagne électorale) de Vladimir Poutine en mars 2004 et, surtout, depuis l’abolition de l’élection des gouverneurs russes au suffrage universel direct, qui était leur source principale de revenues (Wilson, 2005; Raviot, 2008). En bonne logique, ce sont les mêmes polittekhnologui moscovites qui, dépités d’avoir conseillé le perdant, ont analysé sa défaite afin de poser les jalons d’une riposte russe dans un « étranger proche » qui, à en juger par le ton employé, s’annonçait redoutable. Dans l’introduction du premier ouvrage de la collection sur les « coups d’Etat de couleur » lancée en 2005 par une maison d’édition moscovite dirigée par Gleb Pavlovski[6] – célèbre politologue issu de la mouvance « démocrate » devenu, à l’heure Poutine, le conseiller en images du Kremlin – la Russie de Poutine était décrite comme en proie à « une offensive américaine comparable à celle que l’Allemagne avait lancé contre la Russie en 1917 », une tactique qui avait débouché sur le « coup d’Etat d’octobre 1917 »[7]. Trois ans plus tard, la riposte russe aux « révolutions de couleur» n’a pas dépassé le stade du vœu pieu. Une cohorte de journalistes et de publicistes du tout-Moscou continue d’appeler à la mise en œuvre d’un soft power russe: la Russie doit mettre en œuvre son propre réseau d’ONG et déployer à son tour un soft power, sur le modèle américain. Toutefois, si l’on cherche à dresser l’inventaire des initiatives tangibles en ce sens, l’on doit se rendre à l’évidence: la constitution d’un soft power russe n’en est guère qu’au stade du balbutiement (Kononenko, 2006). En mars 2005, la creation, dès le lendemain de la déconvenue ukrainienne, d’une nouvelle Direction des relations interrrégionales et culturelles avec les pays étrangers au sein de l’administration présidentielle et la nomination à sa tête de Modest Kolerov, un politologue qui se distinguait par la publication d’éditoriaux virulents contre l’« interventionnisme démocratique occidental » et en faveur d’une « meilleure diffusion des valeurs démocratiques russes », proche de Gleb Pavlovski, fut interprétée comme le signe avant-coureur du déploiement d’une véritable contre-offensive idéologique de la Russie[8]. Pour l’essentiel, l’activisme de Kolerov, qui ne se déployait guère que dans les cercles mondains de l’expertise et du commentaire de la capitale russe, est resté cantonné à ces cénacles restreints de l’establishment.
Le soft power russe s’est-il enlisé? Les logiques qui régissent la sociologie des notabilités moscovites permettent sans doute d’expliquer, pour une très large part, l’évolution selon laquelle la volonté de riposte s’est transformée en une stratégie de retraite, ou plus exactement de consolidation idéologique du statu quo politique russe. Après la « révolution orange » en Ukraine, une grille de lecture s’est imposée au sein de l’establishment de la capitale russe: Moscou serait le veritable objectif de la nouvelle « vague démocratique » planifiée à Washington, qui n’aspirerait qu’au renversement du pouvoir russe. Certains opposants de la mouvance démocratique, en quête de références politiques positives, s’en félicitent alors, citant en exemple la nouvelle Ukraine « orangiste ». L’ancien ministre Boris Nemtsov, chef du parti SPS, rejoint même les rangs de l’administration Iouchtchenko. D’autres, en revanche, beaucoup plus nombreux, s’alarment de ces événements de Kiev qui sont sur toutes les lèvres et qui – fait rarissime dans une Russie où la politique intérieure des pays étrangers n’est que rarement commentée dans les grands médias – ne cessent d’être citées en référence dans le traitement de l’information sur la Russie même. Tout porte à croire que la « révolution orange » constitue la véritable origine de la « démocratie souveraine », qui marque l’abandon définitif, dans le discours officiel russe, de l’idée d’un aggiornamento démocratique et l’affirmation sans ambages de l’idée d’une démocratie spécifique. La Russie suivrait une voie vers la démocratie qui lui est propre, avec pour axe central la restauration de l’autorité de l’Etat, mise à mal par les réformes économiques de l’ère Eltsine. La mise en avant d’un discours « souverainiste » sur la démocratie légitime fort opportunément l’adoption, en 2006, d’une législation qui restreint l’activité des ONG étrangères sur le territoire de la Russie, un vote qui intervient dans le contexte de la tenue d’un discours officiel offensif sur la question. Dans son adresse à l’Assemblée fédérale du 26 mai 2004, le Président russe avait évoqué les ONG comme des « organisations non-politiques » et condamné sans réserve les organisations « dont l’objectif n’est pas de prendre en compte des intérêts des gens, mais de recevoir le financement d’influentes fondations étrangères ou de servir des intérêts commerciaux douteux ou ceux de certains groupes » et dont « la voix est inaudible lorsqu’il s’agit de défendre les droits fondamentaux les plus élémentaires de l’individu pour la bonne raison que (ces organisations) ne peuvent mordre la main qui les nourrit »[9]. Dans cette logique, certaines organisations, accusées d’abriter des activités de subversion politique (Fondation Soros) ou d’être des « nids d’espions » (British Council), voient leur activité entravée ou interdite. Dans une exégèse de la pensée politique de Vladislav Sourkov – l’auteur du concept de « démocratie souveraine » – qui a reçu l’imprimatur des conseillers politiques du Président russe, Alexeï Tchadaïev a expliqué que la « révolution démocratique globale » orchestrée par les Etats-Unis dans diverses régions du monde n’a d’autre but que « d’affaiblir des systèmes politiques désignés comme autoritaires à des fins d’ingérence ». Dans ce contexte, la Russie doit « consolider son propre modèle démocratique », dans la mesure où la démocratie ne saurait se limiter « à l’organisation périodique d’élections au suffrage universel », à la « comédie des partis et des lobbies » ou « au simulacre du changement de pouvoir tous les quatre ans ». Légitimant le caractère plébiscitaire et présidentialiste du système politique russe, l’auteur livre cette formule éloquente : « c’est le peuple russe, et non Washington, qui doit décider de quel pouvoir il veut » (Tchadaïev, 2006, p. 34). Dans la bouche de Sourkov comme sous la plume de Tchadaïev, la « démocratie souveraine » n’est pas une idéologie dont l’exportation servirait à limiter l’impact des entreprises de démocratisation « à l’occidentale » dans les Etats post-soviétiques, mais plutôt une grille de lecture destinée à apporter la contradiction au bloc euro-atlantique l’Occident sur la scène internationale. Certaines positions russes en défense d’une interprétation stricte de la souveraineté des Etats – par exemple, l’opposition de principe de Moscou à l’indépendance du Kosovo – se trouvent ainsi renforcées par une certaine mise en cohérence. A moins que l’on considère cette nouvelle idéologie comme destinée en priorité à une usage bureaucratique interne: en effet, elle fournit par sa simplicité un précieux canevas de prêt-à-penser pour la nouvelle classe des « fonctionnaires politiques » du parti pro-présidentiel. Seul l’avenir permettra de juger de l’efficacité du tout nouvel «Institut de la démocratie et de la coopération», un think tank non-gouvernemental russe qui a ouvert, en janvier 2008, deux bureaux à l’étranger – l’un à New- York, l’autre à Paris – dont l’objectif est de faire concurrence aux grandes ONG américaines, du type Human Rights Watch ou Freedom House. Bien que destinée à être financée par des fonds privés provenant de grands groupes russes, tel Gazprom, cette ONG a été placée sous le patronage « informel » de Vladimir Poutine, qui s’était publiquement félicité de cette initiative avant même sa création… Son responsable, l’avocat Anatoli Koutcherena, membre de la Chambre sociale de la Fédération de Russie, précise qu’il s’agit de « fournir une analyse plus objective de l’état de la démocratie dans les pays occidentaux » et, le cas échéant, d’organiser « le monitoring des élections et des droits de l’homme » dans les pays de l’axe euro-atlantique. Ce nouvel institut vise également « à apporter la contradiction aux institutions occidentales sur le terrain de l’analyse du système politique de la Russie » et à contribuer à influer positivement sur la fabrication de l’image de la Russie sur le marché de l’information[10].
L’affaire Khodorkovski, ou la réactivation des mythologies de la « guerre froide »
Tous les travaux précités sur la politique américaine de promotion de la démocratie ont montré qu’il est impossible de la considérer comme une politique publique soigneusement coordonnée et dirigée d’en haut. Toutefois, la Democracy Promotion est en quelque sorte orientée par des normes non-contraignantes (guidelines) édictées par le Congrès des Etats-Unis. Ainsi, le préambule du Russian Democracy Act adopté en octobre 2002 affiche l’objectif de « faire évoluer les données de la politique intérieure russe dans le sens de la démocratie »[11]. Le Congrès des Etats-Unis édicte régulièrement des actes législatifs indiquant les manquements de tel ou tel Etat aux principes démocratiques, en désignant, le cas échéant, les chantiers prioritaires. Le texte précité, qui débloque une ligne de crédit de 50 millions de dollars, en désigne deux: la liberté de conscience – avec pour perspective l’octroi d’une plus grande liberté d’action pour les églises et les sectes évangéliques dont l’activité est dirigée à partir des Etats-Unis – ainsi que la liberté d’expression. En ce qui concerne cette dernière, le texte ne se contente pas de déplorer « la censure et l’autocensure qui sont la règle dans les médias russes », mais condamne aussi de manière explicite la fermeture de l’actionnariat de la presse et des grandes chaînes de télévision au capital étranger… Comme dans tous les domaines de la politique étrangère et sur tous les terrains où se déploie de l’action internationale protéiforme et multivectorielle des Etats-Unis, ce sont les divers lobbies, qui ont pignon sur rue dans la capitale fédérale américaine, qui déterminent l’orientation des priorités et qui façonnent l’esprit public dominant sur telle ou telle question. Dans un ouvrage foisonnant d’exemples, Stephen Cohen a montré que pendant toutes les années 1990, l’esprit public américain avait été orienté par les grands médias et la plupart des experts dans le sens d’une véritable « croisade » – dont il énumère les dérives et constate finalement l’échec – en faveur d’une « Russie libérale et démocratique », d’une « Russie américaine, totalement imaginaire ». Cette « opération de désinformation à grande échelle » édulcorait systématiquement les nombreux manquements des dirigeants russes étiquetés « démocrates » ou « libéraux » – parmi lesquels les oligarques – aux principes qu’ils étaient pourtant censés garantir. Ainsi, « les démocrates russes » sont devenus, dans le langage médiatique occidental, une sorte d’avant-garde éclairée toujours en butte à une fraction revancharde – généralement qualifiée de nationaliste et/ou de nostalgique de l’URSS – de l’élite post-soviétique, et à un peuple russe toujours nostalgique de la main de fer (Cohen, 2001).
De la même manière qu’il existe une « Chine américaine » (Viltard, 2003), il existe une « Russie américaine » dont il faut mettre à jour les origines intellectuelles et politiques si l’on souhaite comprendre le terreau sur lequel se développe la « nouvelle guerre froide » des années 2000. Faute de pouvoir en dresser ici un panorama exhaustif, contentons-nous de signaler une piste qui nous paraît fructueuse. Il faut partir empiriquement d’un constat d’ordre chronologique: l’offensive verbale de Washington – d’abord officieuse, puis officielle – contre le déficit démocratique en Russie ne coïncide ni avec l’arrivée de Vladimir Poutine au Kremlin (2000), ni avec les « révolutions de couleur » (2003-2005), mais avec un épisode généralement qualifié de « campagne contre les oligarques ». Au printemps 2001, la chaîne de télévision privée d’orientation libérale NTV est reprise par Gazprom Media, une filiale de Gazprom, monopole gazier dont l’Etat russe est l’actionnaire majoritaire, dans les conditions d’un raid qui ne laisse planer aucun doute sur la volonté du pouvoir d’écarter l’oligarque Vladimir Goussinski, PDG d’un groupe Most en cours de démantèlement, de la sphère des médias. Après que ce dernier, suivant l’exemple de Boris Berezovski, a émigré pour fuir les poursuites judiciaires engagées à son encontre en Russie, l’arrestation à grand spectacle de Mikhaïl Khodorkovski, dont l’avion est arraisonné le 25 octobre 2003 sur le tarmac de l’aéroport de Novossibirsk, une grille de lecture se cristallise, en vertu de laquelle une « nouvelle ère de répression politique s’est ouverte en Russie »[12]. En avril 2003, le patron du géant pétrolier Youkos – alors toute première fortune de Russie – avait annoncé la fusion prochaine de son groupe avec la compagnie Sibneft. Des rumeurs aussi persistantes que dignes de foi indiquaient que le magnat russe avait entamé des négociations avec ExxonMobil et ChevronTexaco en vue d’une prise de participation importante de ces dernières dans le capital du futur nouveau géant pétrolier mondial. La couverture médiatique du procès Khodorkovski, qui s’achève par la condamnation de ce dernier en juin 2005 pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, a diffusé en priorité l’image d’un procès politique orchestré par le Kremlin. L’activisme politique du prévenu en faveur du libéralisme, tout comme ses prêches sur le « business éthique » – éléments d’une stratégie de respectabilisation qui visait les centres de décision américains – furent expliqués à l’opinion occidentale comme appuyés sur une argumentation politique sérieuse, susceptible de lui conférer une véritable audience et, à moyen terme, de faire de lui un adversaire politique de Vladimir Poutine… Les commentaires mentionnaient rarement le fait que l’ancien patron de Youkos était devenu le lobbyiste de l’industrie pétrolière américaine dans le monopoly des matières premières de la Russie et que son arrestation, ainsi que le démantèlement de sa holding, contrecarraient les intérêts pétroliers et les desseins politiques, si étroitement liés, de l’administration Bush. Sous couvert de dénoncer la dérive autoritaire du Kremlin, c’est en réalité sa volonté de garder la main sur des secteurs stratégiques de l’économie nationale (l’énergie et les ressources naturelles) qui était mise en cause. De plus, Mikhaïl Khodorkovski incarnait une certaine « Russie idéale », du moins vue de Washington – « the kind of Russia we want» – la fine fleur d’une petite élite libérale très prisée par les cercles d’influence américains dont Stephen Cohen dénonce le coupable aveuglement…
Pour comprendre la « Russie américaine » et les raisons de son déphasage avec la Russie réelle, il faut faire un détour du côté de l’ « Amérique russe ». De toute évidence, l’ « Amérique russe » est, elle, cohérence avec la Russie libérale, celle des classes moyennes supérieures, du business et des oligarques (Hoffmann, 2002; Raviot, 2007, pp. 52-59), ne serait-ce que par le prisme de la communauté juive. Rappelons que 70% des émigrés russes aux Etats-Unis depuis 1870 sont des juifs et qu’en retour, les juifs venus de Russie (et leurs descendants), puis les refuzniks d’URSS, et enfin les juifs qui ont quitté les Etats post-soviétiques dans les années 1990, représentent une large majorité de la population juive américaine[13]. Or, si certains travaux ont mis en évidence le rôle décisif joué par un certain nombre d’organisations communautaires juives américaines dans l’orientation de la politique des Etats-Unis à l’égard d’Israël (Mearsheimer et Walt, 2007), ce même travail reste à faire pour ce qui est de la Russie post-soviétique. Dans la mesure où ces organisations ont réussi à faire de la question de l’émigration des Juifs soviétiques le verrou des relations américano-soviétiques dans les années 1970 (Peretz, 2006), on ne peut que parier sur une certaine continuité des structures et des méthodes d’action qui ont fait leur preuve. En outre, les années 1990 ont été le théâtre, en Russie, d’un notable renouveau des structures communautaires juives auquel les oligarques – en particulier Boris Berezovski, Vladimir Goussinski et Mikhaïl Khodorkovski – ont pris une part active. Cet activisme visait à créer des espaces de sociabilité d’affaires alternatifs à ceux de l’ancienne nomenklatura économique. De plus, les nouveaux réseaux communautaires juifs de Russie, au premier rang duquel figure le Congrès juif de Russie, longtemps présidé par Goussinski, ont bénéficié du soutien des grandes organisations juives américaines et mondiales (notamment celui du Congrès juif mondial), elles-mêmes très bien représentées dans la vie publique américaine. Sans attendre de disposer d’un tableau complet des articulations réticulaires entre l’ « Amérique russe » et de la « Russie des oligarques » – un tableau qui reste à peindre – il faut souligner à quel point l’affaire Khodorkovski suscite la réactivation des mythologies de la « guerre froide », voire de mythologies bien antérieures, puisque l’on peut retrouver la trame des récits mobilisés dans la véritable « guerre de l’information » russo-américaine qui eut lieu autour des pogroms de Kichinev (1903-1905) (Slezkine, 2004). Alexandre Soljenitsyne n’a pas manqué de relever que ces massacres avaient donné lieu à de multiples opérations de désinformation, les enjeux symboliques dépassant largement le souci de la vérité historique (Soljenitsyne, 2002). Deux cryptocraties symétriques s’affrontent sur le champ de bataille des imaginaires de la « nouvelle guerre froide ». En forçant à peine le trait, nous les résumerons ainsi. Sur les rives du Potomac et de l’Hudson, l’hydre cosmopolite de la finance fourbit les armes qui lui permettront de prendre le contrôle de la Russie, dont la valeur se résume à ses ressources naturelles et à la profondeur stratégique de son territoire. Les oligarques – en majorité juifs – constituent une « cinquième colonne » plus ou moins téléguidée d’outre-Atlantique, tout acquise à la cause du mondialisme[14]. Maîtres du secret et patrons des innombrables officines du tentaculaire appareil de la sécurité d’un Etat russe qui porte encore les stigmates du totalitarisme, un petit groupe d’hommes issus du KGB – des Slaves ivres de revanche après l’humiliation de la chute de l’URSS, avides de s’enrichir au passage en mettant hors-la-loi, à des fins d’expropriation, les individus les plus créatifs et les plus entreprenants – ont scellé un pacte secret afin de débarrasser la Russie de ses oligarques, puis de toute influence étrangère et, demain peut-être, de toute présence étrangère (Politkovskaïa, 2005)[15]…
Conclusion:
Le continent européen est-il de nouveau la proie d’une division entre deux modèles, l’un promu par la Russie et l’autre par l’Occident ? Force est de constater que les élites russes et celles des pays de l’Union européenne ne parlent pas le même langage politique. Un observateur a noté que le dialogue entre la Russie et l’Union européenne s’apparente à un dialogue de sourds entre les promoteurs, européens, d’un « Etat post-moderne » et d’une « démocratie post-nationale », en quête d’un ordre politique transnational et post-étatique fondé sur les droits de l’homme et l’ « ingérence démocratique », et les tenants, russes, du réalisme le plus classique, attachés à un modèle politique fondé sur la souveraineté de l’Etat (Krastev, 2007)… Cette analyse rencontre un certain écho dans les cercles de l’expertise en Russie[16]. Elle rationalise l’air du temps et atténue l’effet de réalité provoqué par la rudesse des rapports de force en fournissant une explication d’ordre historique aux stratégies à très court terme qui se déploient dans le champ de la « guerre de l’information ». Dans les années 2000, les médias occidentaux ont recyclé sans complexe les poncifs de la guerre froide pour redessiner ce qu’il est convenu d’appeler « l’image de la Russie ». L’actualité fut propice à entretenir cette grille de lecture: l’aventure militaire prolongée en Tchétchénie rappelle celle de l’Afghanistan (1979-1989), les assassinats de journalistes engagés contre le pouvoir évoquent le combat des dissidents et l’empoisonnement au polonium d’Alexander Litvinenko renvoie à la célèbre affaire des « parapluies bulgares », qui avait elle aussi pour théâtre la capitale britannique… En réalité, les territoires de la « nouvelle guerre froide » ressemblent davantage à des sables mouvants qu’à l’espace bien délimité, quadrillé et balisé du jeu d’échecs. Les rivalités engagées s’apparentent moins à une guerre, fût-elle « froide », qui opposerait deux camps idéologiquement déterminés, qu’à une guérilla larvée qui déplace constamment et qui nécessite, de la part des protagonistes, une veille permanente et suppose une capacité de réaction instantanée. La « nouvelle guerre froide » se nourrit de l’exploitation, au jour le jour, des images et des représentations changeantes d’une conjoncture qui ne l’est pas moins, de la maîtrise du newsline des agences de presse, de l’excellence au jeu de la réplique et de la polémique. Elle est désormais rythmée par les échéances électorales, qui sont devenues l’un de ses principaux champs de bataille, conséquence de l’instrumentalisation de la question démocratique à des fins de lutte d’influence. La « nouvelle guerre froide » relève donc d’une véritable « géopolitique du zapping » où faits, événements et informations se mélangent et s’entremêlent, sans hiérarchie ni distinction aucune, terrain propice à la multiplication des stratégies de désinformation (Volkoff, 1999) qui combinent, à un degré supérieur à celui de l’« ancienne guerre froide », réalité et fiction, premier et second degré, vrais et faux espions, vraies et fausses manipulations électorales, vrais et faux coups d’Etat…
Article paru sous le titre « Moscou et la question démocratique : mythes et réalités de la ‘nouvelle guerre froide’ », Hérodote, 2008/2 (n° 129).
Bibliographie:
Avioutskiï, Viatcheslav, Les révolutions de velours, Paris, Armand Colin, 2006.
Baechler, Jean, Qu’est-ce que l’idéologie ? Paris, Gallimard, 1976.
Carothers, Thomas, In the Name of Democracy: U. S. Policy toward Latin America in the Reagan Years, Berkeley, University of California Press, 1991.
Chua, Amy, Le monde en feu : violences sociales et mondialisation, Paris, Seuil, 2007.
Cohen, Stephen, Failed Crusade : America and the Tragedy of Post-Communist Russia, New York, W. W. Norton, 2001.
Cox, Michael, et alii (dir.), American Democracy Promotion: Impulses, Strategies and Impacts, Oxford University Press, 2000.
Dahl, Robert, Democracy and Its Critics, New Haven, Yale University Press, 1989.
Francart, Loup, La guerre du sens : pourquoi et comment agir dans les champs psychologiques, Paris, Economica, 2000.
Fukuyama, Francis, La fin de l’histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, 1992.
Goujon, Alexandra, « La révolution orange en Ukraine : enquête sur une mobilisation post-soviétique », Critique internationale, n°27, 2005, pp. 109-126.
Goujon, Alexandra, « Le « loukachisme » ou le populisme autoritaire en Biélorussie », Politique et sociétés, vol. 21, n°2, 2002, pp. 29-50.
Hoffmann, David, The Oligarchs : Wealth and Power in the New Russia, New York, Public Affairs, 2002.
Huyghe, François-Bernard, Quatrième guerre mondiale : faire mourir et faire croire, Monaco, Éditions du Rocher, 2004.
Kononenko, Vadim, « Sozdat’ obraz Rossii ?», Rossiïa v global’noï politike, vol. 4, n°2, 2006 : http://globalaffairs.ru/numbers/19/5549.html.
Krastev, Ivan, « Un défi existentiel lancé à l’Europe », Courrier international, n°880, 13-19 septembre 2007, p. 37.
Laruelle, Marlène et Peyrouse, Sébastien, Asie centrale, la dérive autoritaire : cinq républiques entre héritage soviétique, dictature et islam, Paris, Autrement, 2005.
Mearsheimer, John et Walt, Stephen, Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, Paris, La Découverte, 2007.
Michels, Robert, Les partis politiques : essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, Paris, Flammarion, 1914.
Peretz, Pauline, Le combat pour les Juifs soviétiques : Washington-Moscou-Jérusalem, Paris, Armand Colin, 2006.
Politkovskaïa, Anna, La Russie selon Poutine, Paris, Buchet-Chastel, 2005.
Popper, Karl, La leçon de ce siècle, Paris, Anatolia, 1992.
Prokhanov, Aleksandr, « “Souverennaïa demokratiïa“ – oboronnaïa doktrina Rossii », Zavtra, n°688, 24 janvier 2007.
Raviot, Jean-Robert, « Les voies de la démocratie en Russie », Revue 2050, n°5, 2007, pp. 47-55.
Raviot, Jean-Robert, Démocratie à la russe : pouvoir et contre-pouvoir en Russie, Paris, Ellipses, 2008.
Raviot, Jean-Robert, Qui dirige la Russie ?, Paris, Lignes-de-Repères, 2007.
Robinson, William, Promoting Polyarchy : Globalization, U. S. Intervention and Hegemony, Cambridge University Press, 1996.
Sharp, Gene, From Dictatorship to Democracy : a Conceptual Framework for Liberation, Boston, The Albert Einstein Institution, 2002.
Shevtsova, Lilia, Russia. Lost in Transition : the Yeltsin and Putin Legacies, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2007.
Slezkine, Yuri, The Jewish Century, Princeton University Press, 2004.
Soljenitsyne, Alexandre, Deux siècles ensemble. Juifs et Russes avant la Révolution, Paris, Fayard, 2002.
Soros, George, « Toward Open Societies », Foreign Policy, n°98, printemps 1995, pp. 65-75.
Tchadaïev, Alexeï, Poutine: ego ideologuiïa, Moscou, Evropa, 2006.
Tinguy (de), Anne (dir.), Moscou et le monde. L’ambition de la grandeur : une illusion ?, Paris, Autrement, 2008.
Viltard, Yves, La Chine américaine : « Il faut étudier la Chine contemporaine », Paris, Belin, 2003.
Volkoff, Vladimir, Petite histoire de la désinformation : du cheval de Troie à Internet, Monaco, Editions du Rocher, 1999.
Wilson, Andrew, Virtual Politics : Faking Democracy in the Post-Soviet World, Yale University Press, 2005.
Zakaria, Fareed, L’avenir de la liberté. La démocratie illibérale aux Etats-Unis et dans le monde, Paris, Odile Jacob, 2003.
[1] Traduction de l’auteur. Le texte original du discours est consultable sur le site officiel de la présidence russe : http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118097.shtml.
[2] Vladislav Sourkov, « Nacha rossiïskaïa model’ demokratii nazyvaetsia souverennoï demokratieï », 7 février 2006, texte publié sur le site internet du parti Russie Unie : http://www.er.ru/news.html?id=111148.
[3] Voir l’interview accordée par Vladislav Sourkov à l’hebdomadaire Der Spiegel, le 20 juin 2005.
[4] http://hrw.org/english/docs/2006/01/18/russia12218.htm.
[5] http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2007.
[6] http://www.europublish.ru. Gleb Pavlovski dirige la « Fondation pour une politique efficace » (Fond effektivnoï politiki), un think tank moscovite proche du Kremlin : http://www.fep.ru.
[7] Elena Afanassieva, Gossoudarstvo ili revolioutsiïa, Moscou, Evropa, 2005, p. 15. Cet ouvrage est préfacé par Sergueï Markov, politologue moscovite proche de Russie Unie, ancien conseiller de Viktor Ianoukovitch.
[8] Voir l’interview de Modest Kolerov, « Ne vsë v jizni – administrativnyï rynok », publiée sur le site internet http://www.polit.ru, le 20 juillet 2005.
[9] En russe, ONG est traduit par le signe NPO, nepravitel’stvennye organizatsii (organisations non-gouvernementales), sigle que Vladimir Poutine reprend en le transformant en nepolititcheskie organizatsii (organisations non-politiques). Voir http://www.kremlin.ru/appears/2004/05/26/0003_type63372type63374_71501.shtml.
[10] « Rossiïa s odobreniïa Poutina sozdaet analititcheskiï tsentr po izoutcheniïou zapadnoï demokratii », publié le 18 janvier 2008 sur le site : http://www.newsru.com/russia/18jan2008/centr.html#1.
[11] Voir Russian Democracy Act, H. R. 2121, 23 octobre 2002, consultable sur le site internet de la Chambre des représentants des Etats-Unis: http://www.house.gov/burton/RSC/Lb100702.pdf.
[12] Un exemple parmi d’autres, http://www.nytimes.com/2004/11/07/weekinreview/07chiv.html.
[13] Table ronde du 17 mai 2005 au Wilson Center (Washington) sur les conséquences de l’immigration russe sur la politique extérieure des Etats-Unis au XXème siècle: http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?event_id=116667&fuseaction=events.event_summary.
[14] Certains tracts de campagne du parti Russie Unie en décembre 2007 reprennent les poncifs de la propagande anti-capitaliste et anti-américaine. La référence plus ou moins directe à l’existence d’une cryptocratie cosmopolite est un motif récurrent du discours de nombreux partis politiques russes.
[15] Une thèse développée presque en ces termes par Politkovskaïa (2005) et qui, notamment en raison du sort tragique de l’auteur, assassinée le 7 octobre 2006, a fait florès dans les analyses publiées par les grands médias occidentaux, en particulier en France.
[16] Boris Mezhuev, « Modern Russia and Postmodern Europe », Russia in Global Affairs, n°1, 2008 : http://eng.globalaffairs.ru/numbers/22/1176.html.