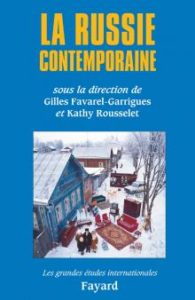L’ère Brejnev : la mutation des élites (1965-1985)

Alors qu’elles visaient à « débureaucratiser » le système politique en rapprochant les dirigeants des réalités économiques et sociales, les réformes menées sous la direction de Nikita Khrouchtchev[1] après le XXème Congrès du PCUS (1956) ont engendré des bouleversements institutionnels qui ont profondément déstabilisé les appareils du parti et de l’Etat. La réforme dite « des sovnarkhozes » (décidée en 1957) et la refonte des organisations du parti (1962), ponctuées par les nombreuses fuites en avant idéologiques et les lubies du Premier secrétaire, ont fini par exaspérer de nombreux responsables des échelons supérieurs du parti, de l’Etat et des instances en charge de la gestion de l’économie, en tout premier lieu les premiers secrétaires régionaux du parti. Incontournables « courroies de transmission » des directives édictées au sommet, ces derniers constituaient la clef de voûte d’un schéma décisionnaire devenu indéchiffrable en raison des changements intempestifs induits par l’agitation réformatrice au sommet.
Le 15 octobre 1964, une réunion plénière du Comité central du PCUS entérine la « démission » de Khrouchtchev et son remplacement par Leonid Brejnev, qui s’installe pour dix-huit ans aux commandes. Les motifs avancés de l’éviction de Khrouchtchev – « subjectivisme, initiatives désordonnées, précipitation, infantilisme, vantardise, phraséologie, ignorance des réalités, mépris des masses » – traduisent dans la langue de bois communiste l’état d’esprit de la majorité des membres du « Parlement du parti ». Brejnev avait discrètement pris la tête de cette « fronde des élites », orchestrant le limogeage de Khrouchtchev avec la même efficacité que celle dont il avait fait preuve sept ans plus tôt pour déjouer, avec l’appui décisif du maréchal Joukov, la tentative du « groupe anti-parti », conduit par Malenkov, de renverser le Premier secrétaire. L’habileté de Brejnev, que ses pairs décrivent volontiers comme un orfèvre de la manœuvre d’appareil, avait même trompé la méfiance proverbiale de Khrouchtchev. S’il avait conçu, à la suite de l’épisode de 1957, une irrépressible suspicion à l’égard de Joukov – limogé quelques mois plus tard pour « bonapartisme » – ce dernier avait gardé toute sa confiance à Brejnev, qui fut dûment récompensé par son élection à la présidence du Présidium du Soviet Suprême en 1960, une fonction honorifique qui lui conférait le rang protocolaire de chef de l’Etat.

L’arrivée de Brejnev à la tête du parti est souvent vue comme l’aboutissement d’une entreprise collective de restauration menée de l’intérieur et conduite par les membres des appareils du parti et de l’Etat – les apparatchiks – afin de rétablir l’ordre institué par Staline et à reconquérir les prérogatives, notamment économiques, qui étaient les leurs avant les réformes de Khrouchtchev. Dès les premières semaines de leur « direction collective », Brejnev et Kossyguine, nommé chef du gouvernement de l’URSS, restaurent le maillage centralisé des ministères sectoriels (dits aussi « ministères de branche ») dans l’économie. Lors du XXIIIème Congrès du PCUS (1966), l’instance collégiale suprême du parti, le Présidium du Comité central du PCUS, reprend le nom de Bureau politique (Politburo) qu’elle avait eu jusqu’au XIXème Congrès du parti (1952) et le poste de Secrétaire général du PCUS – qu’avait occupé Staline jusqu’à sa mort en 1953 – est rétabli.
Conservatisme politique et changement social
Dès le début de l’ère Brejnev[2], une nouvelle cohorte de secrétaires régionaux du parti, de cadres dirigeants des ministères sectoriels et de directeurs d’entreprise est installée dans ses fonctions par Brejnev et Kossyguine. Ces hommes resteront en poste, pour la plupart, jusqu’à la perestroïka. Soucieux de marquer la rupture avec l’ère Brejnev – qu’il qualifie publiquement dès 1986 de « période de stagnation » – et d’assurer la bonne mise en œuvre de ses réformes par des cadres dirigeants loyaux, Mikhaïl Gorbatchev procède à la « relève » – selon l’expression consacrée – des dirigeants régionaux du parti. C’est ainsi que plus des deux-tiers des membres du Comité central du PCUS sont remplacés au cours de la période 1986-1988. Rétrospectivement, l’ère Brejnev apparaît comme empreinte du sceau du conservatisme, pour ne pas dire de l’immobilisme politique. Pour la première fois dans l’histoire de l’URSS, on observe une grande stabilité des responsables de l’appareil du parti et des ministères à leurs postes. Contrairement à leurs prédécesseurs qui vivaient dans la crainte d’être à tout moment les victimes de l’arbitraire des purges, voire, pendant la période stalinienne, d’une élimination physique, ces derniers n’ont cessé de voir leurs positions renforcées, confortés dans leur pouvoir et entretenus dans leur prestige.
Cette stabilité a engendré un second cliché sur l’ère Brejnev – plus répandu que celui de la « stagnation » dans les Etats post-soviétiques – en vertu duquel les vingt années qui précédèrent la perestroïka constituent un véritable « âge d’or ». Loin d’être une parenthèse de l’histoire (heureuse pour les uns, malheureuse pour d’autres), l’ère Brejnev constitue une période de modernisation de la société soviétique. En une génération, celle-ci a encouru une profonde transformation. L’industrialisation et l’urbanisation se sont poursuivies à un rythme soutenu et, surtout, la structure sociale a fait place à l’apparition d’une classe moyenne urbaine, souvent des diplômés de l’enseignement supérieur (général et, surtout, technique). Par conséquent, la stratification sociale, fondée sur la primauté de la nomenklatoura[3] – une bureaucratie politique recrutée par cooptation qui cumule les fonctions de direction de l’Etat, du parti et de l’ensemble de l’économie du pays – entre en porte-à-faux avec la hiérarchie sociale réelle, qui fait la part belle à une nouvelle « classe de spécialistes », une nouvelle intelligentsia dite « scientifique et technique » avide de voir ses compétences professionnelles reconnues à leur juste valeur, demandeuse de méritocratie. Dans un rapport considéré comme l’un des textes fondateurs de la perestroïka, une équipe d’économistes et de sociologues de Novossibirsk soulignaient justement, en 1983, l’insuffisance de la prise en compte du « facteur humain » dans l’organisation du travail en URSS.

Il ne faut pas omettre de souligner que Par ailleurs, tout au long de l’ère Brejnev, la nomenklatoura n’a cessé, elle aussi, d’évoluer en profondeur, tout d’abord quantitativement : en vingt ans, le nombre de postes qui lui sont rattachés a été multiplié par trois, atteignant en 1983 le chiffre de 600.000 pour toute l’URSS. La classe dirigeante soviétique a également évolué dans ses pratiques. S’ils rétablissent la hiérarchie verticale du schéma décisionnel stalinien, les dirigeants, très soucieux de ne pas déstabiliser le système politique, n’en ressuscitent nullement le despotisme : la verticalité est désormais à double sens, au sens où la légitimité des dirigeants suprêmes du parti et de l’Etat dépend étroitement de ceux qu’ils renforcent aux commandes des échelons moyens et supérieurs de l’Etat, du parti et de l’économie. Ainsi, les critères de compétence professionnelle et d’efficacité font leur apparition, de même que les figures nouvelles du directeur d’entreprise, du manager et du technocrate, qui vont entrer en rivalité pour le pouvoir avec la figure de l’apparatchik. En outre, désormais pléthoriques, les appareils sont traversés de conflits de plus en plus fréquents et complexes entre divers groupes de pression sectoriels, réseaux de clientélisme personnels, ethniques ou corporatistes, ou encore clans régionaux. Les conséquences de cette « politisation de la nomenklatoura »[4] se manifeste encore aujourd’hui dans des conflits entre le pouvoir central et les « sujets de la Fédération » de Russie. Enfin, bien au-delà des seuls critères institutionnels, on observe une mutation notable des critères du prestige et de la distinction, de l’essence de ce qui fait que l’on appartient ou non aux cercles dirigeants.
Le parti en quête de légitimité
« Le parti et le peuple sont unis ! » : ce slogan, qui orne l’affiche du XXVIème Congrès du PCUS (1981), constitue l’un des principaux mots d’ordre de la propagande politique menée par le parti pendant toute l’ère Brejnev. Selon George Breslauer, son adoption officielle en 1953, quelques semaines après la mort de Staline, semble annoncer la déstalinisation à venir : les nouveaux dirigeants soviétiques chercheraient alors à anticiper la perte de légitimité politique attachée à la personnalité charismatique du chef défunt en restaurant le principe léniniste de la « direction collective ». Chaque changement au sommet de la direction politique de l’URSS a occasionné la quête, par les nouveaux dirigeants, d’une nouvelle légitimité et, pour ce faire, la recherche de nouvelles sources de légitimation. Khrouchtchev n’avait ménagé aucun de ses efforts pour réactiver la mythologie communiste du progrès. Si l’aventure malheureuse de la mise en valeur des « terres vierges » au Kazakhstan illustre à elle seule les limites du volontarisme khrouchtchévien, force est de souligner que l’optimisme énergique du successeur de Staline se trouvait en phase avec les succès de la conquête spatiale, source de fierté nationale et de foi en l’avenir pour toute une génération de Soviétiques.

L’arrivée du tandem Brejnev-Kossyguine au pouvoir n’a pas échappé à la règle implicite selon laquelle les nouveaux chefs doivent mobiliser le parti et, selon l’expression consacrée, « le peuple tout entier ». Loin de relancer une nouvelle campagne tonitruante et volontariste, Brejnev et Kossyguine vont s’en tenir à un pragmatisme conservateur dans le contexte d’un environnement international en plein bouleversement. Au vu d’un ralentissement sensible de la croissance économique, le tandem va se mettre en quête de nouvelles sources de prospérité. L’un des slogans les plus célèbres de la période – objet de maintes railleries – lancé par Brejnev à l’occasion du XXIVème Congrès du PCUS (1971) est précisément « L’économie doit être économe ! »… L’heure est à l’exploitation plus rationnelle et plus économe des ressources. Ainsi, la loi sur la protection de l’environnement, adoptée en 1971, entérine la prise en compte des facteurs écologiques et du caractère non-renouvelable de certaines ressources naturelles, des critères qui font pour la première fois leur apparition dans un contexte jusqu’ici entièrement dévoué au productivisme. La réforme des entreprises de 1965, qui confère aux directeurs d’entreprise une plus grande autonomie de gestion des unités de production industrielle, constitue un volet crucial de la nouvelle politique économique et sociale de Kossyguine. En outre, choix stratégique décisif pour les décennies à venir, les dirigeants soviétiques, craignant une crise énergétique avec l’épuisement progressif des gisements d’hydrocarbures de la Caspienne et de « Bakou II », font le pari, dès la seconde moitié des années 1960, de la mise en valeur intensive des ressources en gaz et en pétrole de la Sibérie occidentale. Cette option sera confirmée avec la crise pétrolière de 1973, à l’issue de laquelle Moscou choisit de développer l’exportation de ses ressources en lançant la construction de gazoducs et d’oléoducs vers l’Europe. Tout en jetant les bases d’une future puissance énergétique mondiale, l’URSS approfondit sa dépendance technologique et agricole à l’égard de l’Occident : l’Union soviétique rompt définitivement avec l’idéologie autarcique du « socialisme dans un seul pays » et amorce son insertion dans le grand jeu du marché mondial.
Au pragmatisme conservateur des dirigeants soviétiques répond comme écho un désenchantement de plus en plus manifeste des « masses populaires » qui, indifférentes aux mots d’ordre officiels, tendent à échapper aux circuits « traditionnels » de la mobilisation « par le haut ». Si l’on s’en tient à la grille de lecture de l’idéologie officielle, on observe que l’ordre politique ne cesse d’être renforcé : l’avènement du « socialisme développé » est proclamé à l’occasion du XXVème Congrès du PCUS (1976) et la Constitution de 1977 reformuler le rôle dirigeant du parti non plus comme guidant seulement l’Etat et les institutions politiques, mais l’ensemble de la société. L’art. 6 de la nouvelle Constitution dispose que « le PCUS est la force qui dirige et oriente la société soviétique ». Cette énonciation semble démentie par la réalité. Dans une société de plus en plus urbaine et éduquée, on assiste à une désaffection croissante pour les slogans officiels et le collectif incarné par le parti et ses institutions, les blagues sur les dirigeants (en particulier sur la personne de Brejnev) se multiplient[5], les dissidents, plus nombreux que jamais, font l’objet d’une répression accrue à la fin des années 1970, n’empêchant pas la diffusion de plus en plus large, sinon d’une contre-culture ou d’idéaux oppositionnels, du moins d’un certain état d’esprit non-conformiste. Alors que les canaux traditionnels de la mobilisation en faveur du collectif soviétique ont perdu de leur efficacité, le parti n’a jamais été aussi représentatif de la société toute entière. On assiste pendant l’ère Brejnev à une transformation sociologique profonde du PCUS, amorcée dès les années 1950 : celui-ci devient un parti de masses dont la vocation première n’est plus de figurer l’avant-garde (ouvrière) de la société, mais de représenter toutes les couches sociales. A la différence de la théorie stalinienne selon laquelle le parti, « détachement d’avant-garde du prolétariat », devait « avant tout en être le dirigeant, le chef, l’éducateur de sa classe »[6], Leonid Brejnev, dans son discours devant le XXVème Congrès du PCUS (1976), précisait que « le parti est l’expression supérieure de la collectivité, montant la garde de la combinaison juste des intérêts de tous les groupes sociaux et de tous les travailleurs de la société du socialisme développé »[7]. Ainsi, avec en toile de fond la perte de sens de l’idéologie marxiste-léniniste dans la société soviétique, l’ancien « détachement d’avant-garde du prolétariat » s’est mué en une gigantesque machine bureaucratique destinée à la gestion des carrières. Les organisations de base du parti ont été multipliées à tous les niveaux de la société : dans les années 1970, chaque collectif de travail disposait d’une cellule au sein de laquelle est effectué le recrutement de nouveaux membres, sous le contrôle du comité de district. Dès lors, on observe en bonne logique une augmentation substantielle du nombre de membres du PCUS. Ces derniers représentaient 1,2% de la population totale (1 Soviétique sur 82) en 1939, 6,2% en 1961 et ils en représentent près de 7% (1 Soviétique sur 14) en 1986.
| Année | Nombre de membres du PCUS
(total) |
Variation
(en %) |
Proportion de communistes / électeurs (en %) |
| 1961 | 9.275.826 | – | 6,2% |
| 1971 | 12.461.112 | +34,3% | 9,1% |
| 1981 | 17.430.313 | +40,0% | 10,2% |
| 1986 | 19.037.946 | +9,2% | 10,3% |
Source : Michel Lesage, Le système politique de l’URSS, Paris, PUF, 1987, p. 407 et s.
Dès le début de la décennie 1970, la politique de recrutement vise à accroître la promotion des « spécialistes » de l’industrie et à privilégier les ouvriers qualifiés et les techniciens des secteurs de pointe. Ainsi, entre 1976 et 1986, le nombre de communistes dans l’ensemble de l’industrie a augmenté de 14,1%, avec une augmentation record dans les secteurs de l’industrie automobile (+22,9%), l’électronique (+34%) et surtout l’industrie du gaz (+72,6%), des secteurs où le nombre de communistes était jusqu’ici demeuré faible. La ligne générale semble favoriser un recrutement plus méritocratique, en favorisant les professionnels qui se distinguent dans leur domaine d’activités au détriment des « profils politiques » et des apparatchiks. En dépit de ce volontarisme – par ailleurs très inégalement déployé selon les républiques et régions de l’URSS – de fortes disparités subsistent encore, au début des années 1980, dans la densité du maillage des divers secteurs d’activités par les organisations du parti : c’est au sein de l’administration (50% de communistes), dans l’enseignement (1 enseignant sur 3 est membre du PCUS), dans le secteur de la construction (14,5% de communistes), dans les kolkhozes et sovkhozes (10%) et les instituts de recherche (9%) que la proportion de communistes reste la plus forte, tandis qu’elle demeure faible dans les secteur pétrolier (5%), gazier (3%) et très faible dans les secteurs du commerce, de la restauration et du tourisme (moins de 1%). De même, on observe toujours une grande disparité du ratio des membres du parti par nationalité : si 14,6% des Juifs sont membres du PCUS (en 1981), seuls 2,6% des Tadjiks le sont, alors que 7,6% des Russes sont membres du PCUS (ce qui correspond grosso modo à la moyenne soviétique d’alors). Une politique de « discrimination positive » par nationalités, qui vise à rendre les rangs du parti proportionnellement représentatifs de la diversité ethnique de l’URSS, semble s’esquisser dans les années 1970, avec pour résultat qu’au milieu des années 1980, le nombre de communistes issus des nationalités musulmanes a proportionnellement augmenté, alors que celui des Juifs, des Géorgiens et des Arméniens (dont la proportion de communistes était nettement plus élevée qu’en moyenne), a légèrement diminué. L’évolution sociologique la plus notable est l’augmentation du niveau de qualification de ses membres. Le PCUS est en passe de devenir sinon un « parti de cadres », au sens propre du terme, du moins un parti de diplômés. La part des communistes ayant un niveau d’instruction supérieur est passée de 2,7% en 1939 à 15,7% en 1966.
Le phénomène technocratique
S’il est une œuvre cinématographique qui a fixé pour plusieurs générations le récit du destin de la génération d’après-guerre, conférant à l’ère Brejnev une image vivante et nuancée dans la culture populaire soviétique et post-soviétique, c’est bien Moscou ne croit pas aux larmes, de Vladimir Menchov. Le personnage principal, Katia, est une orpheline qui vit dans un foyer de jeunes travailleuses. Le film commence au début des années 1960 : Katia et ses deux amies ont à peine dix-huit ans. Ouvrière dans une usine de constructions mécaniques, elle suit les cours du soir d’un institut supérieur technique pour devenir ingénieur. Le film suit la trajectoire de l’ascension sociale de Katia, devenue très jeune mère célibataire, de son foyer à son triomphe professionnel à la tête d’une usine moscovite de fabrication de biens de consommation. S’il s’attache surtout à suivre les méandres de la vie sentimentale et familiale de Katia, on peut aussi le regarder comme un « documentaire-fiction » qui fournit une grille de lecture toujours fine et relativement réaliste de l’histoire sociale de l’URSS post-stalinienne. Dans une société dont la démographie a été bouleversée par la guerre et où les femmes exercent de nombreuses responsabilités dans tous les secteurs, le scénario relate le parcours impeccablement méritocratique d’une femme moderne et émancipée, qui – entorse notable à la pruderie qui dominait alors – entretient un temps une liaison avec un homme marié, avant de rencontrer l’âme sœur à la fin du film. Sa fonction de directrice d’usine est mise en scène « à l’américaine » : loin de représenter un simple rouage, elle est mise en scène comme une personnalité que sa fonction distingue et situe au-dessus de l’échelle sociale. Katia porte des tailleurs stricts et élégants, elle se promène dans l’usine en donnant poliment mais fermement des directives à ses chefs d’atelier, elle donne des interviews à la télévision… Il est important de noter qu’à la fin des années 1970, le directeur d’entreprise est valorisée au point d’être digne de faire son entrée dans un premier rôle au cinéma.

L’ère Brejnev a été le théâtre de la montée en puissance d’une nouvelle génération de technocrates économiques plus attachés à résoudre des questions pratiques qu’à débattre de questions idéologiques[9]. Ces jeunes technocrates, nés après-guerre, reflet de la nouvelle méritocratie, joueront un rôle politique capital pendant la perestroïka, puis au début de la période post-soviétique, lorsqu’ils orchestreront la privatisation de l’économie. Si le secrétaire général du PCUS, dans la lignée de ses prédécesseurs, tend à donner la priorité à l’industrie lourde et au secteur militaro-industriel, Kossyguine, dans la lignée de Boukharine et de Malenkov, plaide pour relancer le secteur des biens de consommation et des services, toujours négligés dans le schéma de développement soviétique. Dès 1965, le chef du gouvernement de l’URSS engage une réforme décisive qui dote les entreprises d’une autonomie financière limitée, mais réelle (khozrastchiot). Ainsi, la fonction de directeur d’entreprise et les qualités de gestionnaire, soucieux de plus de rentabilité, sont fortement valorisées. Au plan micro-économique, cette réforme permet au directeur d’entreprise de développer une « sphère sociale » (crèches, maisons de repos, camps de vacances, chorales, groupes folkloriques, clubs de sport ou de théâtre, etc.) qui favorise l’émergence de « collectifs de loisirs » où se renforcent les liens privés noués au travail. La micro-société du « collectif de travail » devient le lieu primordial de la socialisation des individus. L’amélioration sensible des conditions de vie d’une grande majorité de la population (construction de logements, baisse de la durée du travail, amélioration de l’approvisionnement) pendant l’ère Brejnev n’est pas étrangère au regain de popularité dont elle a bénéficié, par contraste, au moment des réformes post-soviétiques. En 1971, Kossyguine avait soutenu le projet de créer un Institut de l’Administration de l’Economie Nationale, qui voit le jour en 1977 sous le nom d’ « Académie de l’économie nationale de l’URSS ». Destiné à former les cadres dirigeants de l’économie soviétique – directeurs généraux des entreprises industrielles, économistes-en-chef, hauts fonctionnaires des ministères sectoriels – cet établissement fut baptisé, à la fin des années 1980, le « chaudron des ministres », tant la proportion de responsables promus pendant la perestroïka était élevée. A partir des années 1960, la création de chaires de management et d’administration des entreprises dans les divers instituts et établissements supérieurs soviétiques – généralement baptisées les « chaires ingéniéro-économiques » se multiplient. Chaque secteur de l’économie, chapeauté par un ministère, tend à se doter de sa propre « écurie » de futurs gestionnaires. Ainsi, l’Institut Goubkine du gaz et du pétrole (aujourd’hui « Université du gaz et du pétrole de Russie ») a été l’un des berceaux les plus accueillants pour la formation de l’élite politique de la perestroïka et de l’ère post-soviétique. Cet établissement compte parmi ses anciens élèves les plus célèbres l’ancien Premier ministre Viktor Tchernomyrdine (ancien PDG du géant Gazprom) et le maire de Moscou, Iouri Loujkov.
Au début des années 1980, les dirigeants et les cadres supérieurs de l’industrie et de l’économie (parmi lesquels les dirigeants des grandes entreprises) ont largement investi les rangs de l’appareil du parti. L’arrivée, en 1986, d’une nouvelle cohorte de secrétaires régionaux du parti promus par la nouvelle direction, autour de Mikhaïl Gorbatchev, a encore accentué la « technocratisation » du parti, une évolution qui permit d’entériner l’orientation pragmatique et réformiste voulue par Gorbatchev et son équipe. Toutefois, la consultation des dossiers personnels des cadres du parti au niveau d’une république ou d’une grande région permet de constater que cette « technocratisation » a été largement préparée en amont, tout au long des années 1960 et 1970, par une politique des cadres qui valorise de manière croissante la carrière des « spécialistes » et des directeurs d’entreprise au sein du parti, quand elle n’encourage pas les apparatchiks les plus prometteurs à se doter d’un vernis managérial en les envoyant à Moscou suivre les cours de l’Académie de l’économie nationale ou de l’Académie des sciences sociales du PCUS. La majorité des technocrates promus par Gorbatchev abandonnèrent par la suite (dans les années 1990) leurs positions politiques, alors très fortes, au fur et à mesure de la démocratisation du système politique, accaparés qu’ils furent par un objectif plus intéressant : transformer la propriété collective (qu’ils ne faisaient jusqu’alors que gérer) en propriété privée. La posture politique qu’ils adoptèrent dans les années 1986-1990 allait néanmoins constituer le vecteur de l’idéologie de l’élite du pouvoir post-soviétique dont ils devaient devenir l’un des piliers. À l’appui d’un discours réformiste favorable à l’introduction des mécanismes du marché et d’un certain degré de démocratisation, les anciens technocrates des années 1980 jetèrent publiquement le discrédit sur les apparatchiks, présentés comme dépourvus de toute compétence autre que strictement paperassière et/ou clientéliste. Par opposition à cette « élite du piston » que représentait à leurs yeux les apparatchiks, ils prétendaient incarner une « élite du mérite » qui, en bonne logique, devait accéder en priorité aux postes de décision politique, et non plus seulement aux fonctions de gestion ou d’exécution. Ainsi, la déréliction du système soviétique procède d’une série de mutations au long cours et est étroitement liée à la mutation des élites opérée pendant l’ère Brejnev. La « conversion » de la Russie au capitalisme résulte sans aucun doute de la généralisation progressive, par capillarité entre certains cercles académiques et certains segments de l’élite du pouvoir, de l’idée que selon laquelle la vraie modernité et le vrai progrès passent par l’instauration d’une économie de marché.
De la « noblesse soviétique » à l’élite post-soviétique
Citons de nouveau le film-culte Moscou ne croit pas aux larmes, qui met assez finement en lumière les critères de la distinction et de la hiérarchie sociale soviétique vers la fin de l’ère Brejnev, toujours officiellement « sans classes ». L’héroïne principale Katia, véritable « Mère courage » du « socialisme réel », incarnation cinématographique d’un cursus honorum méritocratique modèle, mais aussi de la solitude engendrée par la modernité, est la nièce d’un vieil académicien qui semble jouir de tous les privilèges de son rang : vaste appartement confortable et ensoleillé dans l’un des gratte-ciels de la Moscou stalinienne, automobile avec chauffeur, vacances estivales dans une confortable maison de repos en Crimée. L’appartement de l’oncle académicien dispose de tous les appareils électroménagers modernes et la caméra s’attarde un temps sur des indices de voyages effectués à l’étranger (parfums et cognacs français, souvenirs kitsch d’une récente croisière en Méditerranée…). Le petit chien de l’épouse de l’académicien vient opportunément compléter le tableau subtilement satirique et subrepticement féroce d’une classe supérieure soviétique où domine un goût bourgeois conformiste et peu raffiné qui, par capillarité, donne le ton dans les couches inférieures, fascinées – telle l’amie de Katia qui s’installe avec elle dans l’appartement en l’absence de ses locataires – par l’aisance matérielle et le prestige social des « hautes sphères » qui semblent répéter, quelques années avant l’arrivée du capitalisme, la partition de leur rôle de futurs « nouveaux Russes ». Ayant rompu avec l’austérité égalitaire de façade prônée par les bolcheviks de la première heure, la nomenklatoura de l’ère Brejnev forme une caste aussi soucieuse de préserver ses privilèges qu’attachée aux hiérarchies internes, formelles et informelles, qui la structurent.

La lecture de l’ouvrage de Mikhaïl Voslensky renseigne sur de multiples aspects de détail très instructifs de la vie quotidienne du petit monde de la « haute nomenklatoura » de la bureaucratie centrale auquel il appartenait. Au début des années 1970, le sentiment d’appartenir à une véritable aristocratie était déjà particulièrement ancré chez les diplomates, les agents du renseignement extérieur et ceux du commerce extérieur, les correspondants de presse à l’étranger et, d’une manière générale, chez tous les fonctionnaires qui avaient le privilège d’effectuer des séjours ou des missions à l’étranger (Voslensky les évalue grossièrement à quelque 3.000). Ainsi, une nouvelle « noblesse » est née au sein de la nomenklatoura, et plus particulièrement à l’intérieur de la technocratie montante de Moscou et de Leningrad. Les membres de cette nouvelle génération de la « noblesse soviétique » – ce terme souligne à dessein le caractère héréditaire des positions acquises, capital institutionnel et symbolique que nombre de ses détenteurs sauront transformer en capital tout court pendant la perestroïka et au début des années 1990 – ne se distinguaient pas tant par l’importance stratégique de leur fonction, l’étendue de leur pouvoir de décision ou leur position éminente dans l’échelle hiérarchique que par le prestige que leur conférait la connaissance d’un monde bien plus vaste que celui des coulisses du Comité central : le monde occidental, sa société des loisirs en plein essor, sa culture de masse, ses mœurs plus libres, ses modes vestimentaires et intellectuelles et ses biens de consommation. Ceux qui voyageaient à l’étranger – diplomates ou agents de renseignement, sportifs de haut niveau, cadres du réseau bancaire soviétique à l’étranger, artistes, joueurs d’échecs professionnels… – formaient un réseau de sociabilité très select. Ce microcosme formait une petite société où l’on s’observait et où l’on se copiait, l’on se recevait et on se mariait entre « gens de bonne compagnie ». Les signes extérieurs de richesse trop voyants étant alors bannis, on exhibait, chose alors permise, ses dernières acquisitions venues de l’Ouest, des biens de consommation absolument introuvables en URSS pour le commun des mortels. Suivant les modes vestimentaires et musicales occidentales auxquelles ils étaient les seuls à avoir accès, les enfants de cette première génération de l’ « élite mondialisée » de l’espace soviétique donnaient le ton à toute la jeunesse de la nomenklatoura puis, ensuite, à toute la jeunesse estudiantine des grandes villes soviétiques, pour laquelle le jean devint, au cours de la seconde moitié des années 1970, un signe extérieur de distinction, de même que la généralisation des cheveux mi-longs des jeunes hommes, jusqu’ici l’apanage des jeunes intellectuels non-conformistes, semblait indiquer qu’un certain non-conformisme rebelle et décalé devenait la norme dans un pays où un service militaire de deux ans et demi est resté obligatoire jusqu’au début des années 1990. Quoique ses membres n’appartinssent pas forcément, et loin de là, au sommet de la nomenklatoura, cette « nouvelle noblesse », cultivée et désenchantée, consumériste et hédoniste avant l’heure, profondément convaincue de représenter la « véritable élite » de l’URSS, a joué un rôle décisif dans l’évolution des mentalités en définissant le nouveau Zeitgeist. À l’heure de la perestroïka, dans une société jusqu’alors fermée qui s’ouvrait au monde, ce petit cercle est devenu l’élite de référence qui rassemblait les personnes dotées, dans leurs domaines respectifs, du capital social et informationnel le plus valorisé par les nouvelles circonstances.

Parmi les membres de cette « noblesse » de l’ère Brejnev, les cadres du commerce extérieur et des établissements bancaires soviétiques à l’étranger ont joué un rôle clef dans les coulisses de la formation du système politique et du capitalisme post-soviétiques, au point qu’il n’est pas exagéré de parler de phénomène dynastique. Plusieurs personnalités de premier plan de l’ère post-soviétique sont issues de cette « noblesse soviétique » en phase avec les affaires mondiales – Evgueni Primakov, ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre de Boris Eltsine, en est une figure presque tutélaire – et, plus particulièrement, de la nomenklatoura de l’appareil du Commerce extérieur soviétique, de ses centrales d’import-export et de ses multiples structures bancaires et sociétés-écran. L’ancien Premier ministre de Vladimir Poutine, Mikhaïl Fradkov, né en 1950, ingénieur diplômé de l’Institut moscovite des constructions mécaniques excellant en anglais, est entré dès 1973 dans la nomenklatoura du Comité d’Etat aux relations économiques extérieures de l’URSS et, à ce titre, a occupé plusieurs postes de conseiller aux affaires économiques dans diverses ambassades d’URSS. Considérons également la trajectoire emblématique de l’oligarque Vladimir Potanine, né en 1961 à Moscou dans une famille dont le père a effectué toute sa carrière dans l’appareil du Ministère du Commerce extérieur de l’URSS et ses représentations à l’étranger. Au milieu des années 1980, cet instructeur du Komsomol de l’Institut d’Etat des relations internationales de Moscou (MGIMO) où il effectuait ses études semblait destiné à une brillante carrière sur les traces de son père et de plusieurs autres membres de sa famille. Une fois son diplôme en poche, ce jeune francophone et anglophone a rejoint l’appareil de Soïouzpromexport, la centrale du Ministère du Commerce extérieur soviétique pour toute l’industrie de l’URSS, puis, en 1987, la banque internationale de coopération économique, qui disposait de filiales dans les pays socialistes et certains pays occidentaux. Dès 1990, les structures de la technocratie soviétique du commerce extérieur ont été privatisées « de l’intérieur » par leurs fonctionnaires, qui sont parmi les premiers bureaucrates soviétiques à avoir compris et anticipé l’ampleur des mutations économiques à l’œuvre. Ainsi, Vladimir Potanine fonde une structure privée, Interros, dès la fin de l’année 1990. En 1994, cette « union coopérative » a accédé au rang des toutes premières grandes holdings russes. Au milieu des années 1990, Potanine est devenu l’un des magnats les plus influents de Russie. Il est aussi le seul oligarque, avec Boris Berezovski, à avoir occupé un poste ministériel, celui de premier vice-Premier ministre chargé de la politique économique, d’août 1996 à mars 1997. Sa démission a précédé de quelques semaines son succès lors des enchères les plus controversées de l’histoire des privatisations en Russie, celle de la vente du combinat géant d’extraction du nickel à Norilsk. Quelques mois plus tard, son groupe, associé au fonds d’investissement de George Soros, s’est vu céder une partie des actifs de Sviazinvest, le géant russe des télécommunications. Ces deux opérations ont propulsé Vladimir Potanine parmi les premières fortunes de Russie. Quatrième fortune de Russie en 1998 selon Forbes, il s’est maintenu – fait significatif – au même rang : en 2007, le patrimoine de cet homme, classé 38ème sur la liste des hommes les plus riches de la planète, est estimé à 13,5 milliards de dollars. Ce n’est pas la moindre des ironies de l’histoire que de constater que la « noblesse soviétique » a servi de pépinière à la formation de l’élite russe du capitalisme globalisé. Vingt ans après l’ouverture des pays de l’ancienne URSS au marché mondial, la connaissance de l’Occident s’est banalisée et n’est plus un signe de distinction ou de supériorité sociale. Toutefois, la maîtrise des codes de conduite du capitalisme planétaire et des circuits financiers de l’élite globalisée est plus que jamais une clef d’accès à l’élite du pouvoir en Russie et dans les Etats post-soviétiques.
Article paru dans une version plus courte dans Kathy Rousselet et Gilles Favarel-Garrigues (dir.), La Russie contemporaine, Paris, Fayard, 2010.
Bibliographie indicative
Amalrik Andreï, L’Union Soviétique survivra-t-elle en 1984 ?, Paris, Fayard, 1970.
Azrael Jeremy R., Managerial Power and Soviet Politics, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1966.
Blackwell Robert E., “Cadres Policy in the Brezhnev Era”, Problems of Communism, n°2, 1979.
Breslauer George W., Khrushchev and Brezhnev as Leaders: Building Authority in Soviet Politics, Winchester, Mass., George Allen & Unwin, 1982.
Constitution de l’URSS, Moscou, Editions du Progrès, 1977.
Hill Ronald J., Soviet Political Elites: the Case of Tiraspol, New York, St Martin’s Press, 1977.
Hough Jerry F. et Fainsod Merle, How the Soviet Union is Governed, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1980.
Hough Jerry F., The Soviet Prefects. The Local Party Organs in the Industrial Decision-Making, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1969.
Lesage Michel, Le système politique de l’URSS, Paris, PUF, 1987.
Lewin, Moshe, La grande mutation soviétique, Paris, La Découverte, 1989.
Partiïnoe stroitel’stvo : naoutchnye osnovy partiïnoï raboty, Moscou, 1985, 2 vol.
Raviot Jean-Robert et Ter Minassian Taline, De l’URSS à la Russie : la civilisation soviétique de 1917 à nos jours, Paris, Ellipses, 2006.
Raviot Jean-Robert, Qui dirige la Russie ?, Paris, Lignes de Repères, 2007.
Rigby Terence H. et Harasymiw Bogdan, Leadership Selection and Patron-Client Relation in the USSR and Yugoslavia, Winchester, Mass., George Allen & Unwin, 1983.
Skilling H. Gordon et Griffiths Franklyn (dir.), Interest Groups in Soviet Politics, Princeton N. J., Princeton University Press, 1971.
Tatu Michel, Le pouvoir en URSS : du déclin de Khrouchtchev à la direction collective, Paris, Grasset, 1967.
Voslensky Mikhaïl, La nomenklatura : les privilégiés en URSS, Paris, Belfond, 1980.
Werth Nicolas, Histoire de l’Union Soviétique, Paris, PUF, 1990, nombr. rééd.
Zemtsov, Ilia A., Tchastnaïa jizn sovetskoï èlity, Londres, Overseas Publications Interchange, 1986.
[1] Nikita Khrouchtchev est né en 1894 et mort le 11 septembre 1971. Il devient Secrétaire général du PCUS à la mort de Staline, en mars 1953. A partir de février 1955, il cumule cette fonction – qu’il fait rebaptiser « Premier secrétaire » en 1956 – avec celle de chef du gouvernement, jusqu’à son éviction en octobre 1964.
[2] Leonid Brejnev est né en 1907 et mort le 10 novembre 1982. Il fut Secrétaire général du PCUS du 14 octobre 1964 à sa mort. De 1977 à 1982, il a cumulé les fonctions de chef de l’Etat (Président du Présidium du Soviet Suprême) et du parti. Pendant toute cette période ou presque, Alexeï Kossyguine (né en 1904, mort en octobre 1980) fut chef du gouvernement de l’URSS (d’octobre 1964 à sa mort) et Iouri Andropov, successeur de Brejnev à la tête du parti, fut le chef du KGB. Né en 1914, ce dernier a dirigé le KGB de 1967 à novembre 1982, devenant alors Secrétaire général du PCUS jusqu’à sa mort, en février 1984.
[3] Rappelons que la nomenklatoura, au sens propre du terme, renvoie à la liste (nomenclature) des postes de direction pour lesquels toute nomination (ou révocation) devait être approuvée – en réalité, elle était décidée au préalable – par l’instance compétente du parti. Par extension, la nomenklatoura désigne la classe dirigeante, c’est-à-dire l’ensemble des personnes nommées ou tenues en réserve pour ces postes.
[4] Khlevniouk Oleg, Sovetskie reguional’nye roukovoditeli ot Stalina do Brejneva : politizatsiïa nomenklatoury », préciser.
[5] Voir Amandine Regamey
[6] Staline Joseph, Questions du léninisme, Moscou, 1949, p. 169, cité par Lesage Michel, Le système politique de l’URSS, Paris, PUF, 1987, p. 172.
[7] Cité par Lesage Michel, op. cit., p. 173.
[8] Film de fiction d’une durée de 2h10 produit par les studios Mosfilm en 1979, réalisé par Vladimir Menchov sur un scénario de Valentin Tchernykh. Le rôle principal (Katia) est interprété par Vera Alentova. Régulièrement rediffusé à la télévision, ce film, qui a reçu de nombreuses distinctions nationales et internationales, est connu d’un vaste public appartenant à toutes les générations.
[9] Un film comme Moscou ne croit pas aux larmes (réalisé en 1979 par Vladimir Menchov sur un scénario de Valentin Tchernykh) illustre parfaitement à l’écran la mutation des élites qui s’opère à l’ère Brejnev et semble vouloir mettre en scène un « monde idéal » qui aurait été dessiné par Kossyguine.