Le prétorianisme russe : l’exercice du pouvoir selon Vladimir Poutine
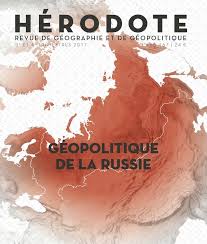
« Les pays du monde qui disposent de leur souveraineté se comptent sur les doigts de la main. Les autres pays sont contraints par des obligations liées aux alliances qu’ils ont contractées, restreignant ainsi volontairement leur souveraineté ». Vladimir Poutine[1]
En dépit d’une médiatisation, inédite dans l’histoire, des circonstances et des péripéties de l’exercice du pouvoir par les hauts dirigeants des Etats de notre planète, la divulgation banalisée de maints détails de leur vie publique et privée, peu de chefs d’Etat commentent leur propre action politique avec autant de distance analytique que Vladimir Poutine[2]. Le chef du Kremlin développe, dans son discours officiel comme dans ses innombrables interventions télévisées ou interviews, une argumentation très cohérente qui s’impose à l’analyste politique et géopolitique et dont il est impossible de faire abstraction. Ainsi, Vladimir Poutine déroule lui-même le fil de sa propre histoire politique, cherchant à maîtriser la mise en récit de son entrée dans l’Histoire. Au cœur de cette argumentation en forme d’autolégitimation, les éléments de géopolitique tiennent une place centrale. Plutôt que de puiser dans des idéologies déjà formulées par des « maîtres » – c’est bien à tort que l’essayiste néo-eurasiste Alexandre Douguine est souvent cité comme « l’idéologue du Kremlin » – ou d’autres grandes plumes de la pensée russe[3], Vladimir Poutine suit, au fil de ses discours, déclarations et entretiens, la trame d’une grille d’analyse assez explicite qui permet à l’observateur attentif de retracer sa vision du monde, et plus précisément sa conception de la place de la Russie dans le monde, et les liens entre cette conception et son action politique.
Donnons ici un aperçu synthétique de la dynamique du poutinisme. Le chef du Kremlin a fixé, pour la Russie post-soviétique, un objectif principal, celui de revenir au centre du jeu mondial, de se replacer parmi les grandes puissances dont la stratégie et l’action déterminent la politique internationale. L’intervention russe sur le théâtre syrien, décidée en septembre 2015, en constitue la démonstration la plus aboutie. Jetée à la périphérie du monde par une décennie de réformes jugées rétrospectivement catastrophiques pour l’économie et le peuple russes, la Russie, pour « revenir au centre », doit renforcer « son Centre ». Le terme de « centre », dans le vocabulaire politique russe, désigne d’abord un lieu : le Kremlin, siège de la présidence russe, cœur de réacteur de l’Etat fédéral, le noyau dur du « pouvoir central » souvent appelé tout simplement « le Centre » [Tsentr]. La dynamique du poutinisme est donc une dynamique centripète, que l’on qualifie ici de kremlinocentrisme. Dans la vision politique poutinienne, c’est en renforçant le centre que l’on jugule le danger d’un éclatement de l’Etat et de la nation russes et son éparpillement vers les périphéries : vers la périphérie du monde (du concert des nations), mais aussi le « débordement » du « Centre » par les « périphéries ». Unifier et réunifier sans cesse la Russie qui menace de se défaire – le parti pro-présidentiel ultra-majoritaire depuis 2000 n’a pas été baptisé Russie Unie [Edinaïa Rossiïa] par hasard –, telle est l’impératif de mobilisation, le « mot d’ordre » poutinien par excellence. Il s’agit précisément à contrecarrer les forces centrifuges qui animent les « périphéries », c’est-à-dire les territoires et les divers groupes et minorités ethniques, nationales et religieuses. Multiethnique, multiconfessionnelle, mais aussi très inégalitaire (et de plus en plus) au plan socio-économique, la Russie ne peut en quelque sorte survivre qu’en consolidant sans cesse une majorité de la société autour de l’Etat russe, véritable bastion – rappelons que le Kremlin est une forteresse…
Plusieurs études relèvent que la Russie de demain sera encore plus inégalement peuplée, socialement et ethniquement clivée que celle d’aujourd’hui et que la distribution du pouvoir (politique, économique et financier) tend à se concentrer, de manière significative et toujours croissante, entre quelques mains [Kossov et Lehuédé, 2013]. La dynamique du poutinisme est donc paradoxale : elle se nourrit d’une réalité géopolitique (tendance endémique à l’éclatement de la Russie sur une ligne Centre-périphéries) à laquelle elle prétend servir de remède, en développant une rhétorique qui, en retour, consolide sa légitimité politique. Cette brève étude retrace les origines, les développements et les ressorts socio-élitaires du poutinisme et se conclut, à rebours de plusieurs analyses prophétisant l’agonie du poutinisme et la fin de l’ère Poutine, en abordant l’entreprise de « ressourcement » du poutinisme à l’œuvre depuis la crise ukrainienne et l’annexion de la Crimée en 2014.
Le kremlinocentrisme
Enclenché dès l’arrivée de Vladimir Poutine à la tête de l’Etat en 1999-2000, le tournant centralisateur du poutinisme est souvent réduit aux slogans très explicites que le président russe lui-même a formulés pour qualifier son action : « rétablissement de la verticale du pouvoir » et « dictature de la loi » [Gelman, 2007]. Cette évolution vers un certain autoritarisme a été rapprochée d’autres processus politiques qui caractériseraient ce début de XXIe siècle : la cristallisation d’un « nouveau modèle d’Etat fort non-libéral » [Tsygankov, 2015], la montée de régimes illibéraux [Zakaria, 1997], non seulement dans certaines démocraties du monde extra-occidental (Turquie, Pakistan, Malaysie) mais au sein même de l’ensemble euro-atlantique (Slovaquie, Pologne, Hongrie). Plus que l’instauration de nouveaux modèles, ces transformations peuvent être analysées comme des dynamiques évolutives et contingentes, produites dans des contextes politiques et géopolitiques très divers. Pour la Russie, la dynamique centralisatrice, celle du poutinisme, peut être qualifiée de kremlinocentrisme, concentration des leviers du pouvoir et des ressources politiques, administratives, financières, médiatiques autour du Kremlin, siège d’une présidence russe dotée d’une pléthorique administration [présidentielle] aux pouvoirs très étendus et qui est le centre nerveux de tout l’exécutif fédéral [Raviot, 2007]. Pendant la période 2008-2012, celle de la tandémocratie[4], on a pu observer que Vladimir Poutine, bien au-delà des prérogatives constitutionnellement définies des fonctions (président ou premier ministre) qu’il occupait, incarnait désormais l’autorité politique suprême du pays, l’arbitre ultime de tous les conflits, le garant intuitu personae de la continuité même de l’Etat russe. Le système politique russe peut donc, sans aucune connotation polémique, être qualifié de monarchie élective [Raviot, 2008].
La dynamique du poutinisme est caractérisée par un mouvement perpétuel de retour au centre. Il s’agit d’une dynamique centripète, qui ramène toujours au Kremlin – centre historique, géographique et symbolique du pouvoir en Russie – les principaux leviers de commande du pouvoir et de l’influence. Dans son essai sur les démocraties illibérales, Zakaria observait qu’elles étaient presque toutes caractérisées par une forte personnalisation du pouvoir exécutif et la concentration du pouvoir entre les mains de présidents (ou de premiers ministres) forts qui, tous, développaient tous une « conception absolue de la souveraineté nationale », un souverainisme exacerbé que l’auteur jugeait vain dans le contexte d’une globalisation économique et financière présentée comme un fait de nature, presqu’inéluctable. Il notait que « la montée de l’illibéralisme procède d’une volonté de maîtriser les conséquences d’une globalisation dont certains chefs d’Etats tel [le président malaysien] Mahathir (…) parlent comme d’un néo-impérialisme occidental » [Zakaria, 1997]. Le kremlinocentrisme procède, en effet, d’une réaction politique visant à protéger la Russie des soubresauts de la globalisation, par ailleurs prétexte à des ingérences politiques et culturelles de l’Occident, dont les élites prônent la gouvernance mondiale et sont hostiles à l’émergence d’un monde multipolaire. L’idée que la globalisation est peu ou prou le bras armé d’un néo-expansionnisme occidental auquel il faut s’organiser pour résister sous-tend le souverainisme et le néo-westphalisme de la politique étrangère russe sous Vladimir Poutine (voir infra).
L’affaire Khodorkovski est l’acte de naissance du poutinisme. L’arrestation, l’enquête et le procès pour fraude et évasion fiscales de la première fortune de Russie[5], avec pour corollaire le démantèlement du groupe pétrolier Youkos, que le magnat avait racheté lors d’une procédure très controversée de privatisation, représentent le meurtre symbolique de ce petit groupe de magnats post-soviétiques que l’on appelait en Russie les oligarques[6], pour souligner par un raccourci la conjugaison de leur puissance financière et de leur influence politique auprès du clan Eltsine. Dès l’arrestation de Khodorkovski, en octobre 2003, une interprétation prend corps et domine tout le commentaire occidental : le Kremlin a voulu faire taire un entrepreneur démocrate et libéral dont les multiples activités civiques et humanitaires laissaient présager qu’il pouvait devenir un opposant sérieux à Vladimir Poutine. Les commentateurs russes, quant à eux, soulignent que l’affaire Khodorkovski intervient dans le contexte politique d’un regain de tension entre Moscou et Washington, par suite du retrait unilatéral des Etats-Unis du traité ABM en 2001[7] et de l’opposition très ferme manifestée par la Russie (de concert avec la France et l’Allemagne) à l’intervention militaire américano-britannique en Irak. En Russie, des voix libérales et pro-occidentales – dont celle de Mikhaïl Khodorkovski – s’élèvent pour critiquer la position du Kremlin et, sinon soutenir, du moins appeler à ne pas gêner l’opération Enduring Freedom. La forte exposition médiatique de Khodorkovski, devenu un personnage familier du tout-Washington et des cercles philanthropiques de Wall Street – dont d’éminentes figures avaient fait leur entrée au directoire de sa fondation – a fini par produire un effet politique. Vladimir Poutine se serait mis à soupçonner le magnat du pétrole de tisser les réseaux d’une véritable politique étrangère parallèle. L’oligarque russe, qui cherchait alors à vendre ses parts (un peu plus de 40%) au capital de Youkos à deux géants mondiaux du pétrole, ExxonMobil et BP, aurait engagé des tractations parallèles avec chacun de ces deux groupes au cours de l’été 2003. Le président russe n’aurait été informé que tardivement de ces manœuvres dans un secteur stratégique capital pour la Russie, lors d’une rencontre avec le directeur exécutif du géant ExxonMobil (dont le PDG était alors Rex Tillerson, aujourd’hui Secrétaire d’Etat), en marge d’un sommet économique à New York, début octobre 2003. Comprenant que Khodorkovski ne visait pas une simple recapitalisation de Youkos mais une véritable fusion du groupe russe avec l’une de ces majors américaines, le chef du Kremlin, désormais convaincu que l’oligarque constituait un danger pour l’intérêt national russe, aurait décidé de ne pas faire obstacle au déclenchement d’une enquête judiciaire contre lui [Sakwa, 2014].
La garde prétorienne du Kremlin
L’affaire Khodorkovski a marqué un tournant décisif dans l’histoire politique de la Russie post-soviétique. En favorisant la coalition, autour du chef du Kremlin, d’une garde prétorienne constituée des responsables des secteurs régaliens de l’Etat – tous des proches du président – qui, à la faveur de cette affaire et au nom des intérêts stratégiques de la Russie, vont rapidement prendre le contrôle (2004-2007) des secteurs stratégiques jugés vitaux de l’économie russe (énergie, armement, aéronautique, technologies de pointe, transports, réseaux et télécommunications), cette affaire a renforcé Vladimir Poutine dans son rôle de capitaine du navire Russie dans l’océan de la globalisation. Pour parer à toute éventuelle « OPA » sur les capacités ou les ressources stratégiques – énergétiques en premier lieu – de la Russie, le Kremlin s’est doté d’un véritable doublon, une structure capitaliste et financière assez informelle fondée sur la solidarité d’un groupe restreint d’une quinzaine hommes unis par la connivence générationnelle, les origines (Saint-Pétersbourg) et/ou professionnelle (KGB, autres secteurs de la défense ou de la sécurité) [Fel’tchinski et Pribylovski, 2010]. A la tête de ce que certains observateurs ont baptisé Kremlin Inc., on trouve, derrière la figure tutélaire de Vladimir Poutine, plusieurs ministres et hauts responsables de l’exécutif et de l’administration présidentielle qui, avant 2012, cumulaient leur fonction au sein de l’Etat avec une fonction de top manager à la tête du conseil d’administration ou du directoire d’un grand groupe, privé, public ou mixte. L’ancien président Dmitri Medvedev, premier ministre depuis 2012, a longtemps cumulé les fonctions de chef-adjoint de l’administration présidentielle avec celle de président du directoire du monopole Gazprom, incarnant parfaitement ce système de korpokratoura[8][Raviot, 2007, 2008] à la fois bureaucratique et corpocratique. Igor Setchine, aujourd’hui à la tête Rosneft, première major pétrolière russe, incarne, mieux encore que Medvedev, le type même du corpocrate prétorien des sphères supérieures. Conscrit de Vladimir Poutine, ce Pétersbourgeois, diplômé en langues romanes, après une carrière au sein du KGB, a occupé les fonctions de chef-adjoint de l’administration présidentielle (2000-2008), puis celles de vice-premier ministre (de Vladimir Poutine, entre 2008 et 2012), tout en présidant le directoire de Rosneft (2004-2011). Autre figure emblématique de cette corpocratie prétorienne, Sergueï Tchemezov, qui dirige depuis 2007 à la tête de la corporation d’Etat [goskorporatsiïa] Rostekh (hautes technologies civiles et militaires) après avoir dirigé Rosoboronexport (monopole d’Etat de l’exportation d’armements), et occupe depuis 2012 des fonctions importantes au sein du parti Russie Unie. Afin d’illustrer les réalités de la korpokratoura, qu’en janvier 2017, indiquons qu’il siégeait au directoire de cinq grands groupes russes (aviation, automobile, banque) et ne dirigeait pas moins de cinq directoires de grands groupes ou corporations d’Etat russes (dont Rosoboronexport).
Spécialiste de la Turquie, Ahmet Insel a donné du prétorianisme une définition qui, presque mot pour mot, pourrait être transposée pour la Russie d’aujourd’hui: « processus à travers lequel l’armée [ici : les responsables des secteurs régaliens de l’Etat], soutenue par la haute bureaucratie civile, s’érige en pouvoir politique indépendant, soit en ayant effectivement recours à la force, soit en menaçant d’y recourir », soulignant aussi l’importance de l’idéologie prétorienne partagée par les membres d’un petit groupe sociologiquement très soudé : « le prétorianisme s’est institué dans la Turquie républicaine comme une idéologie qui met en premier plan l’urgente nécessité de sauvegarder l’Etat des périls qui peuvent provenir de l’extérieur mais surtout des menaces représentées par divers ennemis intérieurs » [Insel, 2008]. La garde prétorienne du Kremlin peut donc être définie comme un réseau non-institutionnalisé qui opère, au sein de l’élite dirigeante, comme un verrou. Peu visible à l’œil nu, ce groupe oriente les grandes décisions stratégiques, arbitre les jeux d’influence et tranche les conflits d’intérêt les plus importants. Ce verrou prétorien s’est cristallisé autour du Kremlin dès les premières années de la présidence Poutine. Il pèse lourd au sein des institutions, notamment au sein du Conseil de sécurité, structure consultative que le président réunit tous les samedis. D’une remarquable continuité, sa composition a peu varié depuis quinze ans. Néanmoins, la question se pose aujourd’hui de la pérennité de ce groupe et de sa capacité à transmettre son pouvoir et sa fortune. Pour l’essentiel, ces hommes sont des siloviki (cadres issus des ministères dits « de force » : Sécurité, défense, Intérieur, … ) au profil militocratique [Krychtanovskaïa, 2004]. A l’heure de la relève des générations au sommet de l’Etat, le profil corpocratique de la classe dirigeante semble bien plus déterminant que ses origines militocratiques, qui s’estompent. Même si nombre d’observateurs continuent de se focaliser sur les héritages du passé, mettant l’accent sur l’identité « néo-soviétique » du noyau dur de la classe dirigeante russe – cette « nouvelle noblesse » issue des rangs du KGB ou des secteurs régaliens de l’Etat soviétique qui s’est emparée des principaux leviers de commande du capitalisme russe [Soldatov et Borogan, 2010] – il faut bien souligner que les patrons de Kremlin Inc. ne sont plus tant des maîtres de la nomenklatoura qu’un groupe dirigeant unifié, plutôt que par ses origines, par sa maîtrise des savoir-faire et des pratiques du capitalisme dans un contexte globalisé. La garde prétorienne s’est donc corpocratisée, en sorte que l’Etat russe est aujourd’hui un Janus à deux têtes : un Etat « classique », au sens régalien et politico-administratif classique du terme, et un Etat-stratège, qui forme un vaste « secteur » économique et financier, allant des vice-premier ministres et ministres des domaines économique, industriel, énergétique et financier aux plus grands groupes publics et privés, en passant par certaines grandes banques et, bien sûr, la Banque centrale. De ces deux pôles de l’Etat, c’est le second qui a pris le dessus : le profil corpocratique efface peu à peu les origines militocratiques.
Souverainisme, néo-westphalisme et guerre de l’information
La politique étrangère est devenue l’un des plus puissants moteurs de la dynamique du poutinisme et l’une des sources de légitimité politique les plus solides de Vladimir Poutine en interne. Sa formulation a évolué, depuis 2000, dans le sens d’un renforcement et d’une clarification de son argumentation. Le discours de Munich (février 2007) marque un tournant : c’est un véritable souverainisme russe qui s’affirme et qui se renforcera par la suite. Avant 2007, le président russe avait déjà maintes fois décrit son action : restaurer la place de la Russie sur la scène internationale – le statut international de la Russie s’étant littéralement effondré pendant les années 1990. Il faut souligner ici l’articulation, essentielle, entre politique extérieure et politique intérieure, très clairement expliquée dans le discours de Munich. L’impératif de la puissance, proclamé par Vladimir Poutine dès son arrivée au pouvoir, ne procède pas seulement d’une volonté de restauration, mais aussi d’une volonté de réaction – il s’agit de conjurer le délitement, voire l’éclatement de la Fédération de Russie, confrontée à des menace plus diffuses d’un nouveau type (terrorisme islamiste, ingérences politiques, économiques ou humanitaires étrangères, fragilité intrinsèque de l’Etat russe, …), des menaces qui obnubilent littéralement une génération de responsables russes qui vient de vivre la chute de l’URSS… La politique étrangère russe comporte donc elle aussi cette dimension prétorienne qui est une marque distinctive du poutinisme. Cette réorientation de la politique étrangère russe vers la reconquête de la puissance s’appuie sur consensus très large des élites et de l’opinion publique russes. Si le discours de Munich structure ce qu’on peut appeler par commodité le souverainisme russe, c’est parce que le chef du Kremlin ne se contente pas d’y décrire la politique étrangère russe mais y développe une vision du monde alternative à celle de l’Occident. Il affirme de manière nette un néo-westphalisme en rupture profonde avec le monde unipolaire dominé par les Etats-Unis et l’ensemble euro-atlantique – des alliés européens que le président russe, par la suite, ne cessera plus de dépeindre comme des vassaux de Washington, allant jusqu’à les comparer aux anciens satellites de l’URSS[9] ! Pour Vladimir Poutine, l’attachement de la Russie à un « ordre néo-westphalien » fondé sur le concert entre des Etats-nations souverains plutôt que sur des normes supranationales ou transnationales, coïncide avec la vision du monde partagée par les grandes puissances non-occidentales (Brésil, Chine, Inde, et même Japon) de ce monde, que certains diplomates russes rêvent de coaliser contre le « nouvel ordre mondial » occidental, qui privilégie le transfert du pouvoir politique à des instances supranationales non-élues.
Dans le contexte de la « nouvelle guerre froide » et de la guerre de l’information qui en est l’une des dimensions, les « techniciens politiques » [polittekhnologui] attachés à l’exécutif russe se sont employés à fabriquer une image plus attractive de la Russie afin de contrecarrer la relance, sur le terrain médiatique occidental, de la fabrication des images d’une Russie hostile, menaçante et réactionnaire. Il s’agit aussi de faire connaître un « regard russe » sur le monde. Au lendemain de la révolution orange en Ukraine (2004-2005), le chef-adjoint de l’administration présidentielle chargé des questions idéologiques, Vladislav Sourkov, avait conceptualisé la démocratie souveraine, un modèle russe de démocratie, non-libérale et non-compétitive, alternatif au modèle occidental dont il s’agissait de nier la supériorité. Sourkov justifiait l’absence d’alternance au pouvoir en Russie (c’est-à-dire l’impossibilité pour l’opposition de gagner les élections contre le pouvoir sortant) par la nécessité de renforcer l’Etat, menacé de l’intérieur par des forces hostiles conspirant à sa destruction [Raviot, 2008]… Le concept de démocratie souveraine ne fut jamais réellement adopté comme une « idéologie officielle » par le Kremlin. Néanmoins, certaines inflexions politiques illibérales et conservatrices, toutes fondées sur une argumentation très voisine, sont à l’œuvre en Europe (notamment dans la Hongrie de Viktor Orban), indiquant qu’un « modèle politique russe » détient un certain potentiel de séduction. Mais si la Russie – du moins les accents conservateurs du discours du chef du Kremlin – apparaît, dans certains milieux de la droite nationale et/ou radicale en Europe ou aux Etats-Unis, comme le nouveau pôle de résistance à la « décadence occidentale », le soft power russe est encore loin d’avoir rassemblé la puissance d’attraction lui permettant de constituer un Konservintern qui serait le pendant de l’ancienne Internationale communiste [Komintern]… Tel n’est pas, d’ailleurs, l’objectif de la politique étrangère russe, si l’on s’en tient au discours prononcé par le président ou son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Loin de vouloir transformer l’ordre du monde ou de favoriser un expansionnisme néo-impérial dans son « étranger proche », la politique étrangère russe poursuit le but de maintenir à tout prix – dans la continuité de l’héritage de la guerre froide – l’équilibre de la puissance avec l’ensemble euro-atlantique dans le contexte d’une asymétrie de puissance dont Moscou a pris la pleine mesure. Face à l’inflexion américaine vers la doctrine de full spectrum dominance à la fin des années 1990, la politique étrangère poutinienne peut être résumée en une formule synthétique : il s’agit pour la Russie de déployer tous les vecteurs de sa capacité de nuisance, tous les instruments de la diplomatie classique et des jeux d’influence à disposition afin de toujours faire ressortir, par contraste, l’impuissance de l’hegemon américain empêtré dans son hyperpuissance [Raviot, 2016, chap. 1]. La dynamique du poutinisme est, en matière de diplomatie comme en politique intérieure, une pragmatique de l’action dominée par la logique – profondément conservatrice – de maintien de la puissance et de continuité de l’Etat.
La montée en puissance de la technocratie
Depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012, la garde prétorienne du Kremlin a entamé une évolution profonde. Tout d’abord, une génération – celle de Poutine (né en 1952) – arrive à l’âge du passage de relais. D’autre part, certains siloviki « historiques » ont été limogés, ce qui démontre la volonté du Kremlin de donner des signes tangibles d’une véritable politique des cadres allant dans le sens d’une promotion des carrières au mérite et à la compétence. Toutefois, nombreux sont les signes qui montrent que l’on assiste à une évolution en profondeur, d’ordre sociologique, de la korpokratoura – et de la classe dirigeante russe dans son ensemble – que l’on peut résumer à une formule : la technocratisation. La génération Poutine s’efface, faisant place à de nouveaux profils, moins sécuritaires et plus technocratique, un type de profils que le nouveau chef de l’administration présidentielle, Anton Vaïno (né en 1972, nommé en 2016), incarne parfaitement. Diplômé du MGIMO[10], une des pépinières traditionnelles de la diplomatie et de la haute administration fédérale soviétique et russe, Vaïno représente le profil-type du tsivilik (les civils – par opposition à la militocratie), ces technocrates de l’administration fédérale, des grands groupes industriels ou financiers et/ou les professions juridiques ou du conseil qui circulent entre ces trois pôles au cours de leur carrière et qui, désormais, supplantent les siloviki au sein de l’élite du pouvoir. La montée en puissance des tsiviliki peut être analysée dans une perspective sociologique plus large : elle est concomitante de la montée en puissance de la classe moyenne supérieure métropolitaine en Russie, une catégorie sociale qui concentre de manière croissante les ressources et les capitaux (matériels et symboliques), en sorte que « la technocratisation de la bureaucratie fédérale représente un embourgeoisement de l’élite russe dans son ensemble » [Diatlikovitch et Tchapkovskiï, 2011], puisque désormais, seuls les enfants des catégories sociales supérieures nés et/ou formés dans les métropoles (Moscou et Saint-Pétersbourg en tout premier lieu) et dûment diplômés ont une chance d’accéder aux postes de cadres dirigeants et même supérieurs au sein de l’Etat fédéral (et, par extension, des grands groupes). Par conséquent, la korpokratoura devrait progressivement se muer en une nouvelle classe dirigeante russe plus nombreuse, mais aussi, paradoxalement, plus concentrée, tant par ses origines géographiques (métropoles, principalement Moscou, Saint-Pétersbourg et les grandes villes millionnaires) que par sa situation – élevée – sur l’échelle sociale. La technocratisation de l’élite russe s’accompagne d’une dynamique centrifuge – par ailleurs observable dans de nombreux autres pays développés, dont la France – qui, sous les apparences de la progression d’une méritocratie (perçue comme très positive dans une société russe qui éprouve une très grande lassitude à l’égard de la corruption), polarisant encore davantage la société entre centre et périphéries (sociales et territoriales). Le système de la korpokratoura tend à s’étendre, tissant la toile d’une nébuleuse corpocratique qui combine réseaux administratifs, politiques, économiques et financiers qui se croisent et s’entrecroisent dans de très complexes alliances d’intérêt, mais aussi clientélistes, népotiques et dynastiques. Les conflits politiques et économiques les plus déterminants se déroulent en coulisses, loin des projecteurs. En raison de l’interdiction faite après 2012 (au nom de la transparence) du cumul de fonctions exécutives au sein de l’Etat et d’un grand groupe, certains grands barons historiques du poutinisme – tel Igor Setchine – se sont repliés sur leurs fonctions à la tête des grands groupes, en sorte que la garde prétorienne des origines a des allures de plus en plus corporate et de moins en moins militaire… Ce sont les intérêts corporate – qu’ils soient strictement privés ou collectifs (clientélistes, népotiques, ethniques, dynastiques) qui prévaudront de plus en plus et supplanteront très bientôt les anciennes solidarités et connivences. Cette évolution de l’élite du pouvoir russe représente un défi sérieux au maintien même d’une garde prétorienne, à la pérennité du prétorianisme et de l’idéologie souverainiste et « patriote » qui lui est consubstantiellement liée. Quid
Vers un retour aux sources du poutinisme ?
Dans un essai récent sur ce qu’il qualifie de doctrine Setchine, Vladimir Pastoukhov prophétise que ce que nous appelons ici le poutinisme atteindra très bientôt son terme. Fragilisé de l’intérieur, confronté à la montée d’une demande de démocratie libérale (plus de méritocratie, moins de corruption, plus d’ouverture internationale, … ) chez les cadres supérieurs de la jeune génération de la corpocratie et de la bureaucratie d’Etat, « le régime policier de Poutine » se disloquera. « Ce système, constitué dans des objectifs de conservation du pouvoir, se propose de geler la société russe pendant encore des dizaines d’années […] ce qui provoquera une révolution et, par voie de conséquence, sa chute inexorable » [Pastoukhov 2017]. Pour Pastoukhov, la technocratisation des élites entraînera une libéralisation du système politique. Les thèses de cet auteur libéral ne sont pas sans rappeler celles de certains dissidents soviétiques qui, dans les années 1970, considéraient que l’évolution (modernisation) de la société soviétique déboucherait immanquablement sur une libéralisation de son système politique… A rebours de cette thèse libérale du « dépérissement du poutinisme », plusieurs facteurs témoignent en faveur d’une relance de la dynamique du poutinisme. Loin d’agoniser, on peut considérer que le poutinisme amorce sa relance. Tout d’abord, le prétorianisme russe, loin de constituer un frein du développement économique, peut être vu, au contraire, comme un moteur essentiel. La centralisation objective des ressources économiques et financières de la Russie font dépendre le développement économique les modalités de l’insertion du pays dans la globalisation d’un nombre réduit de grands secteurs stratégiques liés à l’Etat. Donc, la korpokratoura, qui résulte d’une stratégie économique fondée sur la prise en compte d’une réalité en vertu de laquelle la Russie est et restera dépendante de quelques grands groupes et secteurs (énergie, matières premières, armement), peut être vue comme une configuration parfaitement rationnelle de l’élite du pouvoir russe dans le contexte agonistique de la globalisation. En outre, l’usage légitime de la force (usage des pouvoirs régaliens : défense, police, sécurité, etc.), dans ses dimensions matérielles comme symboliques, reste et restera une ressource-clef du pouvoir, d’autant que d’autres prérogatives régaliennes, moins visibles à première vue (régulation économique et financière, maîtrise de savoir-faire juridiques et judiciaires), ne cesseront de gagner en importance, diminuant ainsi de plus en plus le périmètre d’influence et d’action des siloviki traditionnels (Intérieur, Défense, Sécurité…) au profit de responsables au profil plus technique (surveillance des réseaux, cybersécurité, fiscalité, régulation technique et industrielle, financière, environnementale, …).
En conclusion d’une étude croisée des autoritarismes russe, turc, pakistanais et chinois, Andrei Tsygankov dégage deux stratégies susceptibles de pérenniser ce type de système politique : 1) le contrôle étroit, par le haut, de la composition du noyau dur de l’élite dirigeante, 2) la capacité de l’élite du pouvoir à reformuler constamment des objectifs mobilisateurs pour les différents groupes qui la composent [Tsygankov, 2015]. Bien entendu, la seconde stratégie est la plus payante, à terme. On pourrait ajouter en complément que la capacité des dirigeants à reformuler le répertoire de la légitimité politique constitue un atout décisif. A cet égard, il faut indiquer que l’annexion de la Crimée par la Russie (en mars 2014, à la faveur du changement de pouvoir intervenu en Ukraine en février 2014) et le très fort mouvement d’opinion favorable que cette annexion a suscité en Russie – sous le nom de Krymnach [La Crimée est à nous !] – apporte le témoignage de la grande capacité du pouvoir russe à renouveler le répertoire de sa légitimité par l’intermédiaire des thématiques du patriotisme russe. Par suite du Krymnach et de l’enthousiasme populaire qu’il a suscité, la cote de popularité du président russe est remontée aux étiages de 80% d’opinions favorables, un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis les manifestations de l’hiver 2011-2012. Depuis l’annexion de la Crimée, le chef du Kremlin a appuyé encore davantage la tonalité souverainiste de son discours politique. Dans le discours qu’il a prononcé à Sotchi à l’occasion de la réunion du Club Valdaï en 2014, Vladimir Poutine a haussé le ton d’une manière inédite, accusant les « vainqueurs de la guerre froide » de vouloir gouverner le monde « selon leurs seuls intérêts » et de se conduire « comme des nouveaux riches ayant tout juste acquis une très grosse fortune »… [Poutine, 2014]… De plus, on observe que le président russe a entrepris de favoriser, depuis le tournant de la crise ukrainienne, l’émergence d’une néo-militocratie au sein de l’élite du pouvoir, afin de pérenniser le noyau dur prétorien de l’élite du pouvoir en l’ancrant un profil silovik renouvelé. En témoigne la création de la Garde nationale [Rosgvardiïa] en 2016, confiée à un proche du président, Viktor Zolotov (né en 1954), un homme appartenant au premier cercle (pétersbourgeois) et à la même génération que Vladimir Poutine. La création de ce nouveau ministère « de force » manifeste la volonté présidentielle de renforcer sa garde prétorienne et de souligner encore davantage l’importance qu’il donne aux impératifs sécuritaires dans l’orientation de la politique intérieure et extérieure. En effet, la création de la Rosgvardiïa – un organe directement rattaché au président – étend de manière substantielle le périmètre des pouvoirs du Kremlin en matière de politique sécuritaire. Le chef de l’Etat contrôle désormais, par l’intermédiaire de son pouvoir de nomination du chef de la Garde nationale, un nombre important de forces armées et de détachements spéciaux qui, auparavant, étaient rattachés au Ministère de l’intérieur ou à d’autres ministères « de force ». Au plan symbolique, ce geste est la démonstration d’une volonté de revenir puiser aux sources de la dynamique du poutinisme.
Article paru dans Hérodote n°166/167, automne 2017.
Bibliographie :
DIATLIKOVITCH Viktor et TCHAPKOVSKIÏ Filipp (2011), « Kto est kto v rossiïskoï èlite. Sotsialnaïa set rossiïskikh tchinovnikov », Rousskiï Reporter, http://rusrep.ru/article/2011/09/07/who_is_who
FEL’TCHINSKI Iouri et PRIBYLOVSKI Vladimir (2010), Korporatsiïa. Rossiïa i KGB vo vremena Prezidenta Poutina, Moskva, Terra.
GELMAN Vladimir (2007), « Le retour du Léviathan : la politique de recentralisation en Russie depuis 2000 », Critique internationale, 2007/1 (n°34).
KOSSOV Anastasia et LEHUEDE Hector (2013), « The World of Corporate Governance : Russia », KPMG Audit Committee News, Edition 43/Q 2013,
http://www.kpmg.com/CH/en/auditcommittee/newsletter/Documents/pub-20130916-ac-news-
43-article-09-en.pdf
KRYCHTANOVSKAÏA Olga (2004), Anatomiïa rossiïskoï èlity, Moskva, Zakharov.
INSEL Ahmet (2008), « Cet État n’est pas sans propriétaires ! Forces prétoriennes et autoritarisme en Turquie » in Olivier Dabène et alii, Autoritarismes démocratiques et démocraties autoritaires au XXIe siècle, Paris, La Découverte, pp. 133-153.
PASTOUKHOV Vladimir (2017), « Doktrina Setchina : vzliot i padenie gossoudarstvenno-oligarkhitcheskogo kapitalizma v Rossii », Novaïa Gazeta, 22 mars, https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/22/71873-doktrina-sechina.
POUTINE Vladimir (2007), Discours prononcé lors de la Conférence de Munich sur les politiques relatives à la sécurité, 10 février (version originale), http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
POUTINE Vladimir (2014), Discours prononcé devant le Club de discussion Valdaï, Sotchi, 24 octobre (version originale), http://www.vesti.ru/videos/show/vid/624526/cid/1/
RAVIOT Jean-Robert (2007), Qui dirige la Russie ? Paris, Lignes de Repères.
RAVIOT Jean-Robert (2008), Démocratie à la russe. Pouvoir et contre-pouvoirs en Russie, Paris, Ellipses.
RAVIOT Jean-Robert, dir. (2016), Russie : vers une nouvelle guerre froide ? Paris, La Documentation française.
SAKWA Richard (2014), Putin and the Oligarch. The Khodorkovsky-Yukos Affair, London, I. B. Tauris.
SOLDATOV Andrei et BOROGAN Irina (2010), The New Nobility : the Restoration of Russia’s Security State and the Legacy of the KGB, New York, Public Affairs.
TSYGANKOV Andrei (2015), « A Strong State : Theory and Practice in the XXIst century », Valdai Papers, n°15, mai 2015.
ZAKARIA Fareed (1997), « The Rise of Illiberal Democracy », Foreign Affairs, nov.-déc.
[1] Vladimir Poutine interviewé par le réalisateur Oliver Stone, « The Putin Interviews », 2e partie.
[2] Vladimir Poutine a exercé les fonctions de président de la Fédération de Russie de 2000 à 2008 puis depuis mars 2012. La prochaine élection présidentielle aura lieu en mars 2018. Entre 2008 et 2012, il fut le premier ministre du président Dmitri Medvedev, aujourd’hui premier ministre.
[3] Pour une analyse des références intellectuelles des discours de Vladimir Poutine, Michel Eltchaninoff, Dans la tête de Vladimir Poutine, Actes Sud, 2015.
[4] Néologisme en forme de jeu de mots formé à partir du mot tandem emprunté au vocabulaire du cyclisme. Ce terme désigne la période pendant laquelle, par une sorte de permutation, Vladimir Poutine a occupé la fonction de premier ministre et Dmitri Medvedev (premier ministre depuis 2012) celle de président.
[5] En 2002, Mikhaïl Khodorkovski était classé première fortune de Russie par le magazine Forbes. Le 20 décembre 2013, après dix ans de détention, Mikhaïl Khodorkovski a été libéré par suite d’une amnistie prononcée par décret présidentiel. Il réside désormais en Suisse, d’où il dirige la fondation Open Russia [Otkrytaïa Rossiïa].
[6] Voir l’ouvrage de référence de David E. Hoffman, The Oligarchs. Wealth and Power in the New Russia, New York, Public Affairs, 2002.
[7] Le traité ABM (traité anti-missiles balistiques) a été signé à Moscou le 26 juin 1972 dans le cadre des négociations sur la limitation des armes stratégiques. Ce traité a été confirmé, après la chute de l’URSS, par la Russie et les Etats post-soviétiques. Les Etats-Unis s’en sont retirés unilatéralement, le 13 décembre 2001.
[8] Du russe korporatsiïa (angl. : corporation), grand groupe industriel et/ou financier. Le corpocrate est en ce sens un homme dont la carrière se déroule dans l’univers des instances dirigeantes de ces grands groupes. La korpokratoura est un néologisme forgé par l’auteur visant à associer les mots de korporatsiïa et de nomenklatoura, pour souligner l’imbrication étroite des sphères dirigeantes de la bureaucratie (haute administration) d’Etat et des grands groupes industriels et financiers.
[9] Vladimir Poutine interviewé par le réalisateur Oliver Stone, « The Putin Interviews », op. cit.
[10] Institut moscovite d’Etat des relations internationales et de l’économie mondiale. Voir http://mgimo.ru